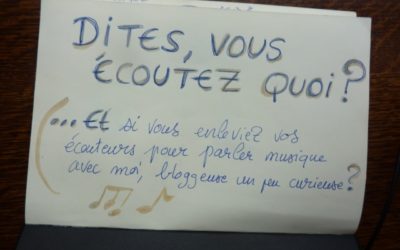La Préfecture de police de Paris annonce l’installation de 1000 caméras d’ici fin 2012. La vidéosurveillance est-elle désormais la référence en termes de lutte contre la délinquance ?
C’est absolument certain. A s’en tenir au rôle et à la place accordés à ce dispositif, non seulement en terme d’effet d’annonce mais à son inscription dans la loi. Elle prend une place considérable dans le dispositif de la Loppsi 2 [Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, ndlr], qui vient d’être définitivement adoptée par l’Assemblée nationale. La Loppsi 2 renforce les moyens qui ont été accordés par la vidéosurveillance dans les lieux publics ou ouverts au public, conforte la situation préexistante et facilite son déploiement.
La vidéosurveillance est au centre du discours gouvernemental concernant la sécurité et contre la délinquance. Elle est la clé du dispositif gouvernemental et elle est au cœur de la loi. Eric Helman, sociologue spécialisé, a parlé d’ « outil miracle ». La vidéosurveillance apparaît comme la solution miraculeuse, quasiment seule puisqu’elle tend à écarter toutes les autres, notamment les dispositifs humains, la présence. Elle est vraiment donnée comme l’outil clé pour résoudre la question de l’insécurité.
A quoi la vidéosurveillance est-elle censée servir : interpeller en flagrant délit ? Dissuader les délinquants potentiels ? Permettre d’interpeller plus tard un suspect après l’avoir identifié par les images ?
Depuis sa légalisation par la loi Pasqua en 1995, peu d’études ont été réalisées sur ce thème. Il y en a eu quelques-unes à partir de 2007, quand le processus s’est accéléré et quand le gouvernement a souhaité lui accorder une place centrale. Ce sont des études contradictoires qui accréditent l’idée que la vidéosurveillance n’a pas d’impact ou un impact très faible. Elle ne permet jamais d’appréhender quelqu’un en flagrant délit. Elle permet tout au plus, de façon très marginale, d’identifier a posteriori l’auteur d’un délit, pour environ 5 % des délits et après un long travail d’analyse des images et de recoupements.
On ne peut donc pas parler de résultats probants ?
Il y a un fossé entre ce qui est attendu de la vidéosurveillance si on s’en tient aux déclarations du gouvernement et ses résultats effectifs. Quand les rapports ne parlent pas d’échec total ou d’absence de corrélation entre la résolution des délits et la mise en place de caméras, dans le meilleur des cas, on peut constater qu’il est possible d’identifier les coupables. Mais, il s’agit-là d’un nombre minime de cas, et ces résultats nécessitent de longues analyses. Cette démarche est d’ailleurs parfois cause d’erreur car l’image n’est pas infaillible.
Malgré tout. C’est une efficacité qui, si elle n’est pas nulle, est extrêmement faible et, en tout cas, hors de proportion avec les moyens déployés pour mettre en place cette technologie.
La vidéosurveillance est appelée à durer. Comment la rendre efficace ?
Rendre la vidéosurveillance efficace revient à se projeter dans un film de science-fiction où l’on pourrait appréhender les personnes en temps réel, si ce n’est anticiper les comportements. Cela suppose également qu’il y ait un surveillant derrière chaque caméra et une caméra derrière chaque citoyen. On se pose alors une question éminemment politique : quelle société voulons-nous ? C’est le cœur de cette question. Et l’absence de clivage politique dans ce domaine est très parlant.
Et la mise en place coûte cher…
Un seul système de vidéosurveillance comporte plusieurs caméras et coûte 400 000 à 500 000 euros. Lorsqu’une commune souhaite s’équiper, les budgets votés s’élèvent à plusieurs millions d’euros. On comprend l’appétit que cela suscite et les marchés entrainés. Avec celui de la surveillance et un lobbying avéré des industriels -issus pour certains de l’armement-, le marché de la sécurité est porteur, y compris en termes d’emplois. Il y a certainement une volonté de ne pas l’entraver.
En incitant les communes à s’équiper, le gouvernement cherche-t-il à répondre favorablement au lobbying ou à rassurer les électeurs ?
La mise en place dans les communes est facilitée par la Loppsi 2. Elle permet dans certains cas de l’imposer au maire par le biais des préfectures. Très schématique, c’est avant tout un argument électoral. Alain Bauer, qui est le grand promoteur de cette technologie, président de la Commission nationale de la vidéosurveillance et conseiller de Nicolas Sarkozy pour les questions de sécurité, a écrit un livre en 2008 [fn]Vidéosurveillance et vidéoprotection, Alain Bauer et François Freynet, Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ?, 2008.[/fn] qui ne fait pas mystère de ses intentions. Compte tenu de la faible efficacité du dispositif, il la vend comme un avantage concurrentiel aux maires. Il faut comprendre « un avantage électoral ». La vidéosurveillance permet de rassurer des populations, de répondre à leur sentiment d’insécurité. Elle est vendue aux maires comme un avantage dans la compétition électorale. C’est avant tout un outil politique, avant d’être un outil sécuritaire qui aurait prouvé son efficacité. C’est un outil "technopolitique".
Le vocabulaire a évolué et aujourd’hui on ne parle plus de vidéosurveillance mais de vidéoprotection. S’agit-il d’une ficelle rhétorique pour convaincre les citoyens ?
Cela participe à la volonté de rassurer en dévoyant le sens des mots, en jouant sur la sémantique. C’est inquiétant puisque ça rappelle les méthodes orwelliennes et c’est un vocable désormais inscrit dans la loi, la Loppsi 2. Les membres du gouvernement, les maires sont désormais sommés d’appeler le dispositif de vidéosurveillance, qui donnait bien sa fonction, surveiller, la vidéoprotection. On passe d’un descriptif de la fonction de surveillance à l’indication de la finalité souhaitée, la protection. On mesure la volonté d’accréditer l’idée que les citoyens sont protégés par cette technique alors que les études n’en apportent pas la preuve.
Mais c’est particulièrement inquiétant. Bertrand Delanoë lui-même a utilisé ce terme de vidéoprotection lors d’une émission, très récemment. Sur cette question, il n’y a plus de clivage entre la majorité et l’opposition.
On connaît les positions sur ce sujet de Patrick Balkany et de Christian Estrosi, respectivement Maire UMP de Levallois et de Nice. Mais aujourd’hui on voit les maires socialistes de plus en plus enclins à équiper leur commune.
Je ne vais pas sonder le cœur de tous les maires de gauche, je ne généraliserai pas. Quand Patrick Balkany ou Christian Estrosi s’expriment, les propos sont toujours outranciers. On sait bien que leur discours sombre souvent dans l’excès.
C’est vrai que le Parti socialiste a fait son aggiornamento sur cette question de la vidéosurveillance depuis le discours de Villepinte en 1997 pendant lequel Jospin a indiqué que la sécurité était la première des libertés. Depuis, il y a une conversion progressive, une acceptation ou une réticence moins affichée qu’auparavant des maires socialistes.
Si on s’en tient aux principaux représentants de ce parti, il n’y a plus d’objections de principe catégoriques à la mise en place de la vidéosurveillance. A Paris, il y a une acceptation et une reprise du vocable officiel. Il n’y a plus de clivage gauche/droite sur ce point. Si j’étais à la sécurité à l’UMP, je dirais que la bataille a été gagnée au moins sur le plan des principes.
Quelles influences a la vidéosurveillance sur la question des libertés individuelles ?
La loi Pasqua de 1995 avait été déférée au Conseil constitutionnel ; ce dernier avait considéré que la technique était susceptible de présenter une menace pour les libertés individuelles, comme celle d’aller et venir. Il est difficile de façon abstraite de répondre. Il est clair que se déplacer sous l’œil des caméras provoque un sentiment d’intrusion dans un espace qui est public, celui de la liberté de circuler.
Ensuite, il y a aussi la nécessité de fournir aux citoyens une information claire et accessible sur le sort qui est réservé aux images. Un droit dû aux citoyens mais qui, en pratique, est loin d’être effectif. Sur le plan du droit, les problèmes qui se posaient en 1995 sont toujours d’actualité : qui contrôle, avec quelles garanties ? Quelle est l’information donnée à ceux qui sont filmés ? Quels est leur droit d’accès, comment peuvent-ils l’exercer ? Comment s’assurer que le temps légal de conservation des images, un mois, est bien respecté ? Des questions simples qui, dans la pratique, soulèvent des difficultés.
Pourquoi le gouvernement et les pouvoirs ne communiquent-ils pas sur ces aspects ?
Le problème est qu’il existe une contradiction intrinsèque entre la finalité du dispositif qui est de surveiller et de surprendre, et l’information qui peut permettre d’échapper à cette captation d’image ou à la rendre moins efficace. Les garanties sont contre-productives si l’on s’en tient à la finalité des dispositifs qui sont de nature à inquiéter. L’information au public peut lui faire prendre conscience qu’il est observé de plus en plus fréquemment à l’occasion des déplacements. Ceux qui mettent en place les dispositifs ne sont pas toujours au fait des obligations qui leur incombent. Celles-ci nécessitent des frais, une réflexion dont la plupart font l’économie.
Tout comme les citoyens ne sont pas au fait de leurs droits…
De ce point de vue là, il y a une vraie ignorance. Mais on ne peut pas le leur reprocher car il s’agit d’une loi méconnue, très technique. La population informée est persuadée que c’est la CNIL [Commission nationale de l’informatique et des libertés, ndlr] qui est compétente pour contrôler les dispositifs. La Loppsi 2 vient d’introduire, en pointillés, la possibilité pour la CNIL d’opérer un contrôle, à la demande des commissions départementales. Jusqu’à présent et pour simplifier, la CNIL n’était pas compétente pour la vidéosurveillance dans les lieux. La Loppsi 2, suite au lobbying du président de la CNIL, a introduit la possibilité de faire appel à elle pour opérer un contrôle sur place. Mais on ne voit pas comment, compte tenu de la faiblesse de ses moyens, elle pourrait se rendre dans un petit village de province pour contrôler ce que fait un bistro. C’est un vœu pieux et presque uniquement un effet d’annonce. Le contrôle effectif est quasi-inexistant et quasiment impossible à mettre en pratique.
Si la Loppsi 2 introduit la possibilité d’un contrôle par CNIL, celle-ci n’a pas la compétence à autoriser ou refuser la mise en place d’un tel dispositif. C’est le préfet et la commission départementale -qui ne tient qu’un rôle consultatif- qui le peuvent. Cela n’a pas bougé depuis 1995.
Pour vous, cette question est-elle très importante ?
Je crois qu’on s’intéresse trop à la technique et pas assez à la façon dont tout ceci est réglementé. Cela me semble important, au-delà du nombre de caméras utilisées et de la technologie, de s’intéresser à la façon dont on a réglementé cette technique. Savoir que la CNIL a été écartée du contrôle est déjà intéressant. La CNIL est une administration qu’on a voulu de façon plus ou moins fictive, détachée de l’Etat. Et même cette administration intra-étatique n’a pas le contrôle sur cette technique. Elle représente un attribut de souveraineté que l’on a voulu prévenir de toute immixtion fusse-t-elle opérée à l’intérieur même de l’Etat par l’une de ses administrations. Le préfet relève de l’Etat, donc l’installation des caméras relève de l’Etat seul.
En 1995, suite à la vague d’attentats terroristes, cela a correspondu à la volonté de l’Etat de revenir sur le devant de la scène sur le plan sécuritaire. Depuis 1995, et aucun gouvernement ne l’a remis en question, il y a une réelle volonté d’affichage politique, un discours électoral assumé sur le sécuritaire qui s’est accompagné par une volonté d’écarter toute intervention extérieure, y compris la CNIL.
Il s’agit in fine de redonner à l’Etat ses attributs régaliens ?
Oui, le message est d’affirmer que la vidéosurveillance est au cœur du pouvoir de police de l’Etat.
David Forest, Abécédaire de la vidéosurveillance, Editions Syllepse, Coll. Arguments et Mouvements, 2009.