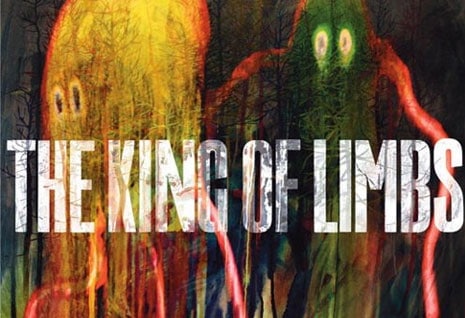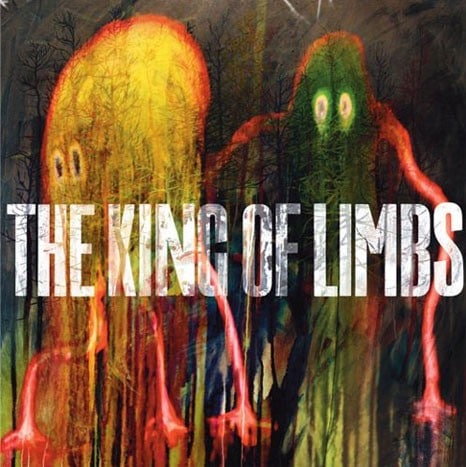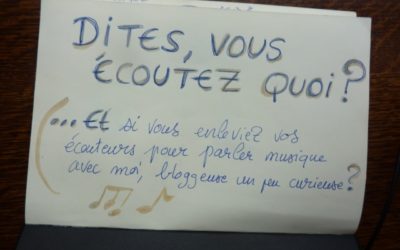Entretien avec Virginie Berger. Fan de musique, passionnée par les artistes, cette ancienne directrice artistique de MySpace a décidé de se lancer en freelance et d’incarner une alternative aux majors. Et elle est loin d’être la seule. Avec son agence, Don’t believe the Hype, elle conseille labels, entreprises et artistes.
Lundi, Radiohead annonçait la sortie de son nouvel album The King of Limbs. Les fans pourront le télécharger dès le 19 février ou commander le CD physique le 9 mai prochain. Aujourd’hui, les artistes peuvent-ils tourner Internet à leur avantage ?
Sans Internet, où serait la musique en écoute immédiate ? Il permet à des millions de personnes de s’exprimer, de déposer leur musique. Tout le monde n’a pas envie d’être une rock star, une star de major. Par contre, je suis contre le piratage ! Je n’ai pas de problème moral par rapport à ça, je comprends qu’un gamin télécharge un titre. Ce que je ne supporte pas, ce sont les types qui passent la nuit sur Internet à graver des CD en piratant de la musique. Je suis opposée au piratage parce que je pense à l’artiste et à son œuvre.
Il est grand temps d’expliquer ce qu’est une œuvre et comment on réalise un disque ! L’artiste a travaillé pour ça. Il faut arrêter de penser que c’est Universal qu’on pirate. Celui qui est lésé, c’est l’artiste. Si les majors ne s’étaient pas braquées à ce point il y a dix ans, on n’en serait certainement pas là. L’industrie des jeux vidéo a eu un tout autre comportement. Elle aussi a été largement piratée et pourtant, elle n’a jamais autant marché !
Et puis, ce n’est pas uniquement le piratage qui a fait du mal aux maisons de disque. Quand elles ne proposent, pendant des années, que la Star Academy, le public croit qu’il n’y a rien d’autre dans la musique que le marketing ! Je n’ai rien contre les maisons de disques, mais nous sommes nombreux aujourd’hui à vouloir travailler différemment.
Le slogan de votre agence est Save the music, not the industry. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Je trouve qu’on passe beaucoup trop de temps à se demander comment on peut sauver l’industrie du disque, à savoir les majors. Mais on ne se questionne pas suffisamment sur la manière dont on peut accompagner et développer la musique dans ce nouvel écosystème. Je m’intéresse aux artistes. Comment les aider ? Comment développer de nouveaux business models et moyens de productions plutôt que de marteler dans les consciences le tout sécuritaire pour que les majors ne perdent pas de parts de marché. On ne parle que de Loppsi, Hadopi, piratage, voleur. Et l’artiste dans tout ça ?
C’est ça la musique éthique et solidaire ?
Tout à fait. Et ça veut dire qu’il faut se poser les bonnes questions. Personne ne parle plus jamais du statut de l’artiste alors qu’il est indispensable de le remettre au cœur de la problématique ! Les artistes sont mal représentés dans les syndicats. Ils ne sont pas consultés lorsqu’il y a des accords passés avec iTunes ou Spotify (écoute de musique en streaming, NDLR). A force de leur dire qu’ils vont dans le mur, ils ne savent plus à quoi se raccrocher et subissent toutes les décisions qu’on prend pour eux. En plus, ils ne sont pas toujours au courant de leurs droits ou des réalités actuelles. C’est compréhensible, ce n’est pas leur métier !
Aujourd’hui, il y a de la place pour tout le monde : les majors, les distributeurs, les sites de streaming, mais pas pour les artistes. Il faut qu’ils retrouvent une place. Il s’agit de leur œuvre quand même ! C’est pour ça que les artistes avec lesquels je travaille restent propriétaires de leurs titres, parce qu’il me semble impensable de leur prendre à vie.
Je ne suis pas seule à le penser. J’ai rencontré au Midem (Marché international de la musique, organisé chaque année, NDLR) beaucoup de personnes qui pensent comme moi : mettre l’artiste au centre et créer un business model autour de lui et non pas lui imposer un business model type.
Les modèles économiques existent
Peut-on créer un business model aujourd’hui pour un artiste ?
Bien sûr ! Tout dépend de nos objectifs. Moi, je ne suis pas une major et je ne fonctionne pas de cette façon. Son but est de vendre des disques, du physique. Mais on peut vendre des tas d’autres choses avec les artistes !
Prenez ce que propose Radiohead avec son dernier album, The King of Limbs. C’est très innovant : pack de luxe avec de l’artwork, des 33 tours, un CD. Pour 36 euros, il y a une vraie valeur dans ces produits. Ce n’est pas cher.
En 2007, Nine Inch Nails a lâché sa maison de disque et sorti des packs avec des produits de valeur à l’intérieur, allant jusqu’à distribuer des disques signés de Trent Reznor lui-même ! Et l’album s’est aussi très bien vendu sur iTunes, parce que les gens qui achètent l’objet ne sont pas ceux qui achètent la version numérique. Il faut avoir une vraie réflexion sur le business plan, repenser l’objet et remettre l’artiste au centre !
Radiohead revient en 2011 à un prix imposé alors qu’en 2007, ils avaient sorti In Rainbows en "Pay what you want". Qu’est-ce que cela veut dire ?
Difficile à dire. Radiohead a toujours été très indépendant. Ils ne demandent rien à personne et ne veulent pas être pris en exemple. Ils ne donnent pas de leçons. Ils ont seulement estimé qu’il était stratégique d’utiliser ce système, à ce moment-là. En 2007, c’était novateur ; aujourd’hui ça ne l’est plus. Internet va tellement vite ! Maintenant, tout le monde fait du "Pay what you want" un peu n’importe comment. Radiohead a dû penser que ça ne marcherait pas cette fois-ci. Pour ce dernier album, ils font un pack avec une vraie valeur ajoutée, qu’il est normal de payer.
Aujourd’hui, peut-on se passer des maisons de disques ?
Attention, Radiohead a tout de même fait appel à un distributeur pour son disque : XL Recordings. Si on a envie d’être dans une niche, on peut tout à fait se passer de maisons de disque. D’autant plus que les majors n’ont plus les moyens de faire la promo de tous leurs artistes. Beaucoup d’entre eux ne sont même pas développés, ils sont perçus comme peu rentables. Et il existe des tas d’artistes qui veulent seulement diffuser leur musique, rentrer dans leur frais et tourner. C’est tout. C’est formidable pour ça Internet !
C’est vrai que si on veut être une rock star, il faut plutôt passer par une maison de disques, capable d’activer les leviers radio et télé, qui sont aujourd’hui beaucoup plus efficaces qu’Internet pour créer des stars. Mais pour combien de temps ?
Les majors semblent avoir beaucoup de mal à s’adapter à Internet…
C’est vrai que de nombreux sites conçus par des maisons de disques pour faire la promotion d’un artiste ne sont que des plateformes événementielles. Elles ne parlent que de la sortie de l’album. Aucun lien n’est créé entre les fans et les artistes. On met juste en ligne des jeux-concours bidon. Ca ne sert à rien de faire des sites quand on n’a rien à dire ! Il faut comprendre qu’on s’adresse à des personnes installées derrière leur écran, qui sont aujourd’hui des internautes expérimentés. Il faut aller les chercher. Il faut humaniser Internet et s’en servir pour vendre des albums.
On ne peut plus se contenter de sortir un album tous les trois ans et d’attendre que le public l’achète. Il n’y a que Mylène Farmer qui peut faire ça, parce qu’elle a un public de fanatiques ! Actuellement, nous sommes dans une logique de zapping qu’il faut absolument prendre en compte. Il faut donc créer une vraie relation avec son public, une page Facebook peut même suffire. Internet, il faut l’utiliser à bon escient, pas en créant des sites inutiles avec des jeux bidon. Cette stratégie était efficace en 2003, plus maintenant !
Savoir s’entourer
Est-on obligé d’accepter la gratuité ?
Il ne faut surtout pas avoir peur de donner du contenu sur Internet. Les maisons de disques s’y refusent. Pourtant, cela permet vraiment de vendre des disques. Il ne faut pas avoir peur de donner, puisqu’après, on vend davantage. Un titre donné est un titre écouté, téléchargé, partagé qui peut convaincre les acheteurs. Le public a encore envie d’acheter des disques !
Ce qui compte, c’est de créer sa propre équipe autour de soi, avec des personnes pertinentes. On appelle cela l’auto-organisation. C’est exactement ce qu’a fait le groupe canadien Metric, lorsqu’ils se sont lancés avec Mathieu Drouin. Il les a encadrés, développés. Ce mec, très brillant, a développé l’album en ligne, sans le soutien d’aucune maison de disque. Et c’est lui qui a fait ce qu’est Metric aujourd’hui !
La toute petite structure d’Emily White, à New York, a quant à elle, fait la même chose avec Family of the Year, un groupe qui est aujourd’hui capable de remplir la Maroquinerie ! Bien sûr, il faut accepter de ne pas être payé immédiatement et d’être patients. Emily White a développé les Dresden Dolls. Elle était à l’université et elle les a développés toute seule, à la force du poignet !
Les labels indépendants et les artistes souffrent de Deezer, Spotify, YouTube. Pourquoi ne peuvent-ils pas se rebeller ?
Les artistes sont dans une politique de « si quelqu’un s’intéresse à moi, je signe et je ne me pose pas d’autres questions ». Et les labels trop petits n’ont pas suffisamment de portée ! Personne ne les représente correctement lors des négociations avec ces sites. D’autant plus que pour exister, labels et artistes n’ont vraiment pas d’autres choix que d’être présents sur ces plateformes. Les labels ont résisté aux Etats-Unis face à Spotify.
En France, c’est plus complexe. Et souvent incohérent. La Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, NDLR) interdit, par exemple, aux artistes affiliés de donner du contenu sur Internet. De même qu’elle empêche les artistes d’utiliser les creative commons ! Des dispositions complètement ridicules qui sont des vrais freins.
La Sacem est un dinosaure que l’on n’arrive pas à faire évoluer ! On a l’impression que les labels et les artistes aux Etats-Unis sont en avance par rapport à la France…
Oui, c’est vrai. Aux Etats-Unis, il n’y a pas d’aide, pas de subvention ni de statut d’intermittent du spectacle. Donc les artistes n’ont pas le choix, ils sont obligés de se prendre en main. Les aides françaises sont absolument géniales. Elles permettent à un artiste de se développer, de travailler sa musique de prendre le temps d’évoluer. Par contre, aux Etats-Unis, c’est une approche très différente. Le système pousse les artistes à foncer. Ils n’ont pas de questionnements philosophiques, ils avancent.