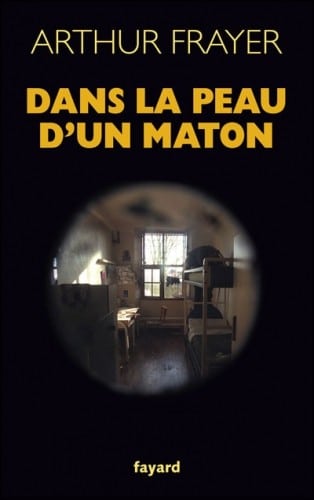Arthur Fayer est un jeune journaliste de 28 ans. Après l’obtention de son diplôme, il a décidé d’infiltrer une prison comme surveillant. La posture n’était ni militante, ni dénonciatrice, il s’est seulement demandé, suite au rapport publié en 2000 sur les conditions de détentions qui soulignait de nombreux dysfonctionnements, où en étaient les prisons. Dans un discours où journaliste et surveillant peinent à se distinguer, Arthur Frayer témoigne de la surpopulation, le mal qui gangrène les prisons. Le mal qui ronge les détenus et les surveillants. De son expérience, Arthur Frayer a écrit un livre. Portrait d’une prison qui va mal. Portrait d’une prison qui ne réinsère plus.
Dans quel état d’esprit avez-vous décidé de passer le concours de surveillant de prison ?
Je l’ai décidé assez froidement. C’est une décision qui ne se prend pas à la légère et qui nécessite une longue réflexion. Je l’ai mûrie sur le long terme. J’y ai pensé lorsque j’étais en stage en presse quotidienne régionale entre mes deux années de journalisme. Durant toute ma seconde année, j’ai réfléchi à la manière de passer le concours. Je me suis renseigné sur le profil de surveillant, sur le type d’épreuves qu’il fallait passer. N’allais-je pas faire tâche avec mon bac+5 ? Etant donné que ce concours est accessible au niveau brevet des collèges. Ce n’est pas un coup de folie. J’ai procédé étape par étape.
Vous êtes-vous entouré pour vous préparer ?
J’ai tout préparé tout seul. J’en ai parlé à ma directrice d’école et à une journaliste du Canard enchaîné mais ça s’est arrêté là. J’ai demandé deux ou trois conseils et c’est tout.
De quelle façon avez-vous procédé après votre sortie d’école ?
Je suis sorti du Centre universitaire d’enseignement du journalisme (Cuej) avec l’idée en tête de passer le concours de surveillant de prison. Il a d’abord fallu que j’effectue mon stage de fin d’études : trois mois à Ouest-France. Ensuite j’ai coupé les ponts avec le journalisme et je suis retourné vivre chez mes parents, pas loin d’Orléans. Et je me suis inscrit en agence d’intérim. Il fallait que je me taille un profil de diplômé précaire pour pouvoir justifier que je passais le concours de maton pour trouver un boulot. Je voulais être crédible en expliquant que je passais le concours parce que je n’arrivais pas à trouver d’autres boulots en accord avec mon niveau d’études. J’ai travaillé dans une scierie, dans une boulangerie industrielle, dans une entreprise de chocolat en poudre. En parallèle, j’ai passé le concours de surveillant parmi d’autres concours : concours de commissariat de police, inspecteur de police. C’était pour anticiper leurs questions lors de l’oral. J’ai passé plusieurs concours pour noyer le poisson.
Quel type de questions ?
C’est-à-dire que s’ils me demandaient : « Avec votre niveau d’études, pourquoi vous ne passez pas le concours de directeur de prison ou de commissaire de police ? » Je leur répondais : « Je les ai passés ces concours, mais je ne les ai pas eus ». Sur le papier, j’étais crédible !
Pourquoi teniez-vous à enquêter sur le milieu carcéral ?
Pendant mon stage, j’ai voulu faire un sujet sur la prison de Fontenay-le-Vicomte (Vendée) qui est surpeuplée. Et le rédacteur en chef m’a dit : « Non, c’est trop compliqué d’avoir les autorisations, on va perdre du temps, laisse tomber ». J’ai donc voulu faire du journalisme, comme je le vois, travailler sur le terrain, sur le long terme, en réalisant un vrai travail d’investigation. J’ai été confronté à une réalité du métier : on n’a pas le temps, on n’a pas les moyens pour enquêter. Et pour les jeunes journalistes c’est encore plus compliqué d’avoir une rédaction qui accepte de nous suivre. Je me suis dit que je n’avais pas grand-chose à perdre à tenter de faire du journalisme comme je voulais le faire.
Vous avez passé le concours, et ensuite ?
La formation dure sept mois en tout avec des périodes de stages. D’avril 2009 à novembre 2009, j’étais en formation dont deux mois et demi de stages, à Fleury-Mérogis et à Châteaudun. J’ai ensuite été affecté en tant que titulaire à la prison d’Orléans où j’ai bossé un mois et demi.
A quel moment vous êtes-vous dit que vous aviez suffisamment de matière pour rédiger un livre ?
Je m’étais fixé trois mois à Orléans. Mais j’étais vraiment à bout sur la fin et c’est ce qui m’a poussé à arrêter. C’était difficile et très compliqué entre le travail de surveillant la journée et, le soir, ma reprise de notes et le travail de journaliste.
Au tout début, dans la prison, qu’est-ce qui vous a le plus interpellé ?
Quand je suis rentré à Fleury-Mérogis, c’est l’immensité et le gigantisme qui m’ont impressionné. Les cris aussi, les insultes et la mise en condition. Ils nous ont avertis d’entrée qu’il ne fallait pas longer les murs parce qu’on risquait de se faire cracher dessus. Les coursives font 100 mètres de long avec quatre-vingts détenus dessus. C’est impressionnant. Comment peut-on gérer une prison ?
Que pensez-vous de la formation de gardien de prison ?
J’ai trouvé que la formation était bonne, même si tout peut toujours être amélioré. Non, le problème c’est ce qui se passe sur le terrain. La formation pourrait être doublée, triplée, ce serait toujours pareil. C’est impossible en prison de bien faire son travail.
A cause de la surpopulation ?
En grande partie, oui, à cause de la surpopulation. On réglerait ce problème et 80% des problèmes de prison seraient réglés.
Concrètement, la surpopulation en prison, c’est quoi ?
A la prison d’Orléans, il y a un seul surveillant affecté par étage. A l’étage, il y a trente-huit cellules d’une place, donc théoriquement trente-huit détenus à surveiller. Théoriquement toujours, les surveillants doivent s’occuper des ces trente-huit détenus. Ils les envoient à la douche, les envoient en promenade… Mais dans les faits, l’étage compte quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze détenus ! Les détenus sont deux à trois par cellule. On prend toujours une minute pour dire bonjour, ça fait en tout une heure trente pour dire bonjour. En gros, j’ai calculé : sur un service de surveillant de six heures, nous n’avons que quatre minutes maximum à accorder à chaque personne. On ne peut pas travailler comme ça. Si on ne prend pas le temps de dire bonjour à un mec mais qu’on lui dit : « dépêche-toi d’aller à la douche », il le prend moins bien. Ce sont des petits détails, mais c’est important. On aura beau changer la formation, ça ne changerait rien. Ce qu’il faut c’est diminuer le nombre de détenus par surveillant pour faire un travail correct.
Cette surpopulation excite la nervosité des détenus ?
Enormément. A trois dans une cellule d’une personne ! Il y a une télé. Il suffit qu’ils ne soient pas d’accord sur le programme : l’un veut regarder le foot, l’autre Plus belle la vie. Tout de suite, ils se mettent sur la gueule.
La tension est telle qu’immédiatement, ils en viennent aux mains ?
L’enfermement et la surpopulation usent les nerfs. Ils sont moins patients, plus irritables et il suffit d’un rien pour que ça dégénère.
C’est ce genre de choses qui vous a le plus marqué ?
Tous ces petits riens qui s’enflamment. Un détenu m’a parlé de ce qu’il appelle la deuxième prison. Quand quelque chose est cassé il faut attendre des semaines pour qu’il soit réparé. Quand on fait une demande à un chef pour travailler, des semaines se passent avant d’avoir une réponse. Tout ceci joue énormément sur le climat de la prison. Les détenus sont, pour la plupart, contre le système et la société et tous ces riens alimentent leur défiance vis-à-vis de la société. Quand une demande reste sans réponse, ils sont persuadés qu’on les laisse attendre intentionnellement, qu’on le fait pour les faire chier. Et la deuxième prison, c’est ça. Il y a l’enfermement et ils pensent qu’on a en plus, le personnel pénitentiaire, un petit côté vicelard. Alors qu’on ne le fait pas exprès, ou alors ceux qui le font exprès sont très marginaux. On manque tellement de moyens. C’est le système ! C’est-à-dire que la faute ne repose pas sur une seule personne mais un peu sur tout le monde en même temps.
Est-il possible d’établir un profil-type des détenus ?
La population pénitentiaire est souvent composée de jeunes de banlieues, de moins de 25 ans pour la plupart. Ils sont là, généralement, pour trafic de haschich ou vol. Mais à Fleury, il y a des violeurs, des terroristes basques, des Chinois détenus pour contrefaçons, même si cela semble caricatural.
Les détenus sont-ils placés ensemble selon les règles prescrites : ceux qui se ressemblent, ensemble ?
On essaie de le respecter mais c’est le gros casse-tête de la pénitentiaire. Ils essaient le plus possible de mettre des mecs ensemble pour que ça n’explose pas. Par exemple, les toxicomanes ne se lavent pas ou peu, ils sont sales. Alors on les met ensemble mais il arrive qu’on mette quelqu’un de clean avec quelqu’un sous Subutex ou Méthadone. Le premier ne veut jamais rentrer dans sa cellule parce qu’il sait très bien qu’elle va être dégueulasse et en plus, il aura peur des maladies. Les pointeurs, aussi, on les met ensemble, les pédophiles ou les violeurs. Parce que si on les met ailleurs, ils vont être frappés par les autres. Ils sont méprisés.
On essaie aussi de mettre les gens des mêmes quartiers ensemble. C’est beaucoup plus simple quand ils se connaissent à l’extérieur. Il faut jouer avec ces facteurs en permanence, auxquels s’ajoutent les facteurs légaux. Un condamné ne peut pas être avec un prévenu. Un majeur ne peut pas être avec un mineur. Tout ça mélangé, c’est un casse-tête permanent !
Ces règles sont-elles respectées ?
Moi j’ai souvent vu des détenus en cellule avec des prévenus, même si c’est interdit.
Cette expérience a-t-elle bousculé vos idées reçues sur les matons et la prison ?
Je suis revenu sur pas mal de choses. Par exemple concernant la relation surveillant-détenu. Souvent, cette relation est assez tendue. Mais parfois, quand un surveillant qui bosse depuis longtemps dans la même prison, voit pour la dixième fois le même détenu, ils discutent de leurs gosses qui ont grandi. Ils discutent d’une gamine qui était en CP et qui va passer son Bac. C’est ce genre de petites choses. Il y a parfois de vrais moments d’humanité. Et au début, c’est assez surprenant de voir ça.
Un autre exemple ?
Moi, j’imaginais les prisons à la Prison Break (série américaine, NDLR). Avec des mecs qui échafaudent toujours des plans d’évasion, des trucs qui pètent dans tous les sens. Mais non, la prison est faite de beaucoup d’ennuis et de routine. Tout est rythmé, quadrillé par le temps. On dit que les surveillants ont un chronomètre dans la tête, les détenus aussi : réveil à telle heure, douche à telle heure, promenade à telle heure, repas à telle heure. On ressent vraiment tout cet ennui. C’est vraiment ce qui m’intéressait, cet ennui. Je voulais savoir ce qu’il y avait derrière, comment on vivait avec. Quand j’avais un peu de temps, je le demandais aux détenus.
C’était marrant, il y avait deux gros bras dans la même cellule et ils avaient mis en place leur petit programme avec leurs tours de ménage. Ils étaient là pour vol ou violence mais il était vraiment important pour eux de s’en tenir au plan du ménage. Ce sont des choses très quotidiennes mais surprenantes.
« Les surveillants aussi sont vraiment usés. Beaucoup tombent en dépression, sombrent dans l’alcoolisme. »
Quel type de rapports entreteniez-vous avec les surveillants ?
Cela dépend des établissements. Dans les maisons d’arrêt qui sont surpeuplées, on n’a que des relations de travail avec les autres, on n’a pas du tout le temps de discuter. Le boulot est très intense. On est seul sur la coursive et on n’a même pas le temps de prendre dix minutes pour boire un café. A Châteaudun, un peu plus, parce que c’est un centre de détention. Par contre à l’Enap (Ecole nationale d’administration pénitentiaire, NDLR), j’avais beaucoup de temps pour discuter avec eux et ils sont devenus mes amis. Ils travaillent un peu partout en France, à Fleury-Mérogis, aux Baumettes à Marseille.
Personne ne vous en veut d’avoir caché votre jeu ?
Non. J’appréhendais, forcément. Mais quand je leur ai annoncé, ils étaient tous plutôt satisfaits qu’on parle du métier de surveillant de prison.
Eux aussi, avec la surpopulation, sont plus nerveux et agressifs ?
Je ne sais pas s’ils sont plus agressifs. Ils sont plus nerveux, c’est clair. Ils sont vraiment usés par leur boulot. Beaucoup tombent en dépression, sombrent dans l’alcoolisme. Le boulot est très dur, mais en plus les jeunes surveillants sont souvent éloignés de leur famille. J’ai un ami qui travaille à Marseille, aux Baumettes et vient de Metz. Il doit se taper des kilomètres à chaque fois qu’il veut voir sa femme et ses enfants. Ce sont des choses qui pèsent. Et beaucoup arrêtent ou finissent par baisser les bras. Après des années à se battre contre des moulins à vent, ils finissent par faire le service minimum.
La prison punit mais réinsère-t-elle ?
La réinsertion, c’est du pipeau. La surpopulation en est un des facteurs principaux. C’est impossible de faire de la réinsertion dans ces conditions. La notion de sécurité de la pénitentiaire est respectée mais celle de réinsertion, pas du tout. Ceux qui se réinsèrent sont vraiment à la marge. Sur deux cents individus, il doit y en avoir un qui se réinsère. Avec quatre minutes à accorder par personne par jour, c’est impossible.
Mais ce n’est pas le rôle du gardien de prison !
C’est le rôle de la pénitentiaire dans son ensemble. L’idéal serait que les surveillants y soient vraiment impliqués. Ce sont eux qui passent le plus de temps avec les détenus ! Les conseillers d’insertion et de probation sont aussi submergés par la masse de travail et de paperasse. L’une d’elle m’a expliqué, un jour, que sur une semaine de cinq jours, elle passait une journée et demie à s’entretenir avec les détenus et, le reste du temps, elle le passait dons son bureau à remplir des papiers et à passer des coups de téléphone. C’est-à-dire que la mission première de leur boulot, ils ne la font pas. Mais encore une fois, ce n’est pas de leur faute. Peut-être que si les conseillers de probation et les surveillants travaillaient ensemble ce serait plus simple.
Que pourraient faire les gardiens ?
Les gardiens pourraient transmettre des demandes, faire passer des messages. « Celui-ci a envie de bosser, il voudrait être menuisier. Il faut lui trouver une formation ». Il y a des gros problèmes de communication dans la pénitentiaire. Le système est très cloisonné alors que les surveillants pourraient faire passer des messages. Un détenu doit écrire pour faire passer un message à un chef. Une fois sur deux, le message se perd ou le chef ne répond pas parce que ce n’est pas un mais deux cents détenus qui lui écrivent. Les détenus n’ont pas de réponse, et ils s’énervent ! Je me souviens de l’un deux qui est allé directement voir le chef parce qu’il n’avait pas de réponse à sa demande de travail. Le chef répond : « écris-moi ». Alors qu’il avait écrit quatre fois ! Il se tapait la tête contre les murs. Il disait : « J’ai écrit quatre fois, qu’est-ce que je peux faire de plus ! » Alors il pète un câble, c’est le seul moyen d’attirer l’attention.
En prison, l’alcool et la drogue circulent-elles ?
Une fois, j’ai trouvé une boulette mais c’est marginal. Un autre jour, deux détenus ont fabriqué de l’alcool en laissant macérer de la mie de pain dans du jus de fruit. Avec la levure, cela a donné un alcool abominable. Ils ont pris une grosse cuite la veille de Noël. Ils étaient blancs comme des linges et ont tout vomi. Mais ça faisait rire tout le monde. Ils étaient censés être punis mais le chef a laissé couler, c’était la veille de Noël.
Quel est votre souvenir le plus marquant ?
Une fausse tentative d’évasion a fait monter une fois la pression. Le type était en promenade et il s’est un peu éloigné. « Mince, je fais quoi ? » J’ai lancé l’alarme. Mais c’était une fausse tentative. Il voulait provoquer son transfèrement. La voie normale, par demande écrite, est beaucoup trop longue. Il a provoqué un incident pour provoquer un transfert automatique. C’était un bordel monstrueux, j’étais en flip total quand je l’ai vu se barrer ! La prison a été bloquée toute la journée !
Votre meilleur souvenir ?
A Orléans, quand on travaillait de nuit durant la période de Noël, le cuisinier, qui est un détenu, nous préparait un énorme plateau de choux à la crème. Et le jeu, c’était d’aller voler le plateau. Le mieux c’était ça, quand on avait le temps de parler avec les détenus.
Dans la peau d’un maton, Arthur Frayer, Ed. Fayard, mars 2011.
> Retrouvez « En prison, pas de projet social », l’interview de l’architecte Augustin Rosenstiehl qui dénonce l’architecture pénitentiaire et son organisation interne.