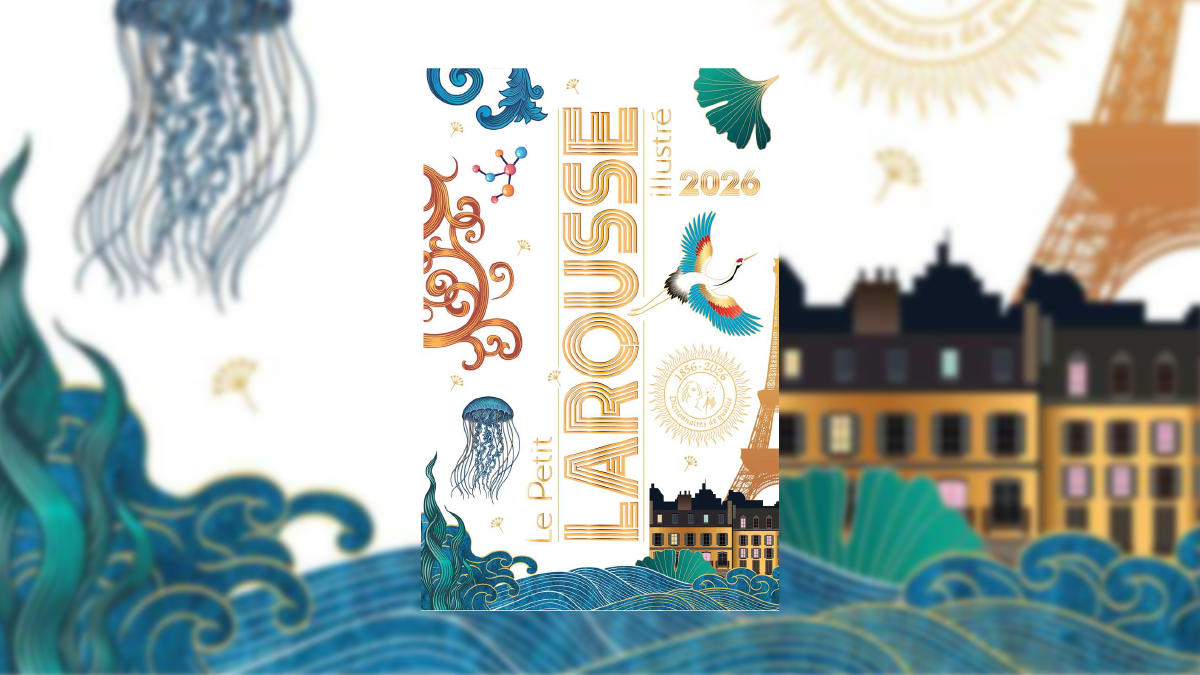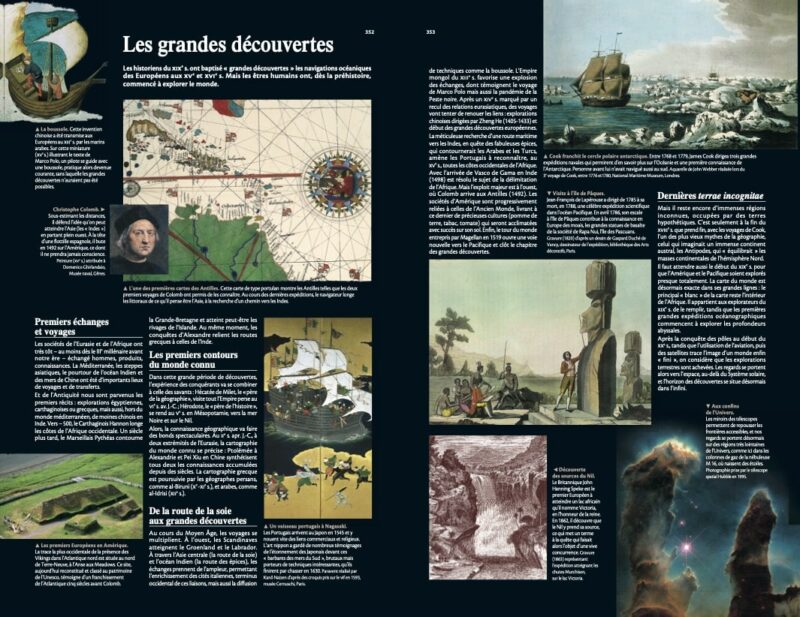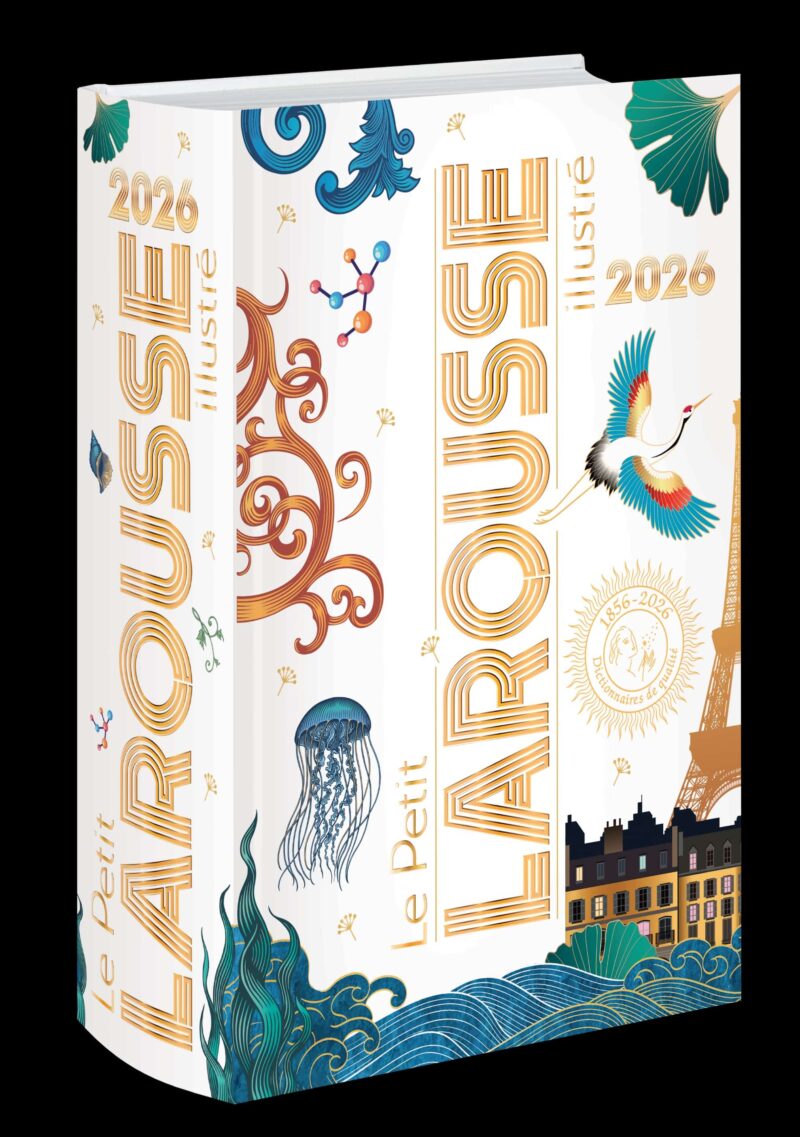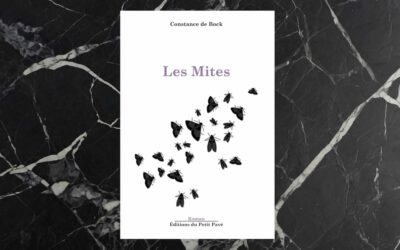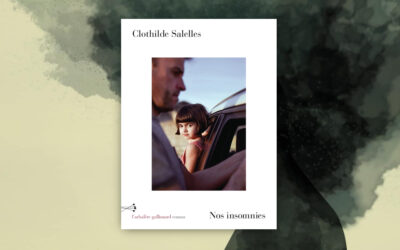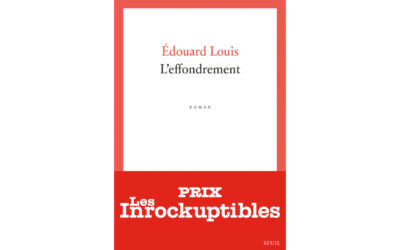Votre bien-aimée rédactrice fait partie de ces enfants qui adoraient, petits, feuilleter avec minutie les pages des dictionnaires, lisant consciencieusement les définitions des mots inconnus. Ce bon vieux dictionnaire, aussi lourd qu’un parpaing et dont les feuilles à la texture de papier à cigarette menaçaient de se déchirer à tous moments. Il faut dire que notre langue française est relativement indomptable, fourmillant de subtilités, d’exceptions et de contradictions pas toujours logiques.
Les gladiateurs des mots
Dans le domaine savant du dictionnaire, la concurrence est féroce d’abord entre Larousse et Littré au XIXe. Le Larousse est vu comme plus accessible, quoique moqué pour ses approximations. On disait du Larousse qu’il instruisait vite et du Littré qu’il instruisait bien. Le Larousse était connu pour dégainer les mots plus vite que son ombre. Dans les années 50-60, avec son dictionnaire analogique, Grand et Petit Robert font une entrée fracassante dans l’arène. Aujourd’hui, hormis les cruciverbistes ou autres scrabbleurs (oui, le mot existe !) et les inlassables archivistes que sont les lexicophiles, qui prend encore le temps de tourner les pages d’un dictionnaire ?
Selon l’enquête GfK publiée par Le Figaro en octobre 2023, les ventes de dictionnaires généralistes et scolaires sont passées de plus de 1,6 million d’exemplaires en 2004 à 567 760 exemplaires en 2023, soit une chute de près de 65%. Le numérique a tout changé, admettent les éditeurs, même si certaines écoles, résistantes, continuent à proposer des dictionnaires papier aux élèves. Mais Le Petit Larousse persiste et signe avec cette nouvelle édition 2026, richement illustrée. Au menu, plus de 63 500 mots, 12 5000 sens et 20 000 locutions et 28 000 noms propres, 1 500 remarques de langue ou d’orthographe, 2 000 régionalismes et mots de la francophonie, 4 500 compléments encyclopédiques, 5 500 cartes, dessins, photographies, schémas et planches.
Au-delà des chiffres en déclin, et pour le bonheur des lexicographes et linguistes, métiers-passion minutieux de la langue et du langage, l’objet dictionnaire demeure un témoin privilégié de l’évolution de notre société.
Petit florilège des nouveaux venus 2026
Les nouveaux mots reflètent les préoccupations et soubresauts de notre société contemporaine : écoquartier, covoiturer, éco-citoyen témoignent de la nécessité de l’élan civique ; lâcher-prise, zénitude, flexitarisme racontent la quête contemporaine de bien-être.
NB : non, le « bravitude » de Ségolène Royal, n’a toujours pas fait son entrée !
Parmi les nouveaux venus :
-
Aplaventrisme, ce mot québécois désignant une attitude de soumission (non, ce n’est pas l’art de se coucher au centre de la pièce).
-
Démence pugilistique, maladie neurodégénérative provoquée par les chocs crâniens répétés, notamment chez les boxeurs et rugbymen.
-
N’en déplaise à certains, le très versatile Bader, entre déprime et inquiétude.
-
L’expression familière « Hey gros, ça va ? », immortalisée dans un dictionnaire, à l’origine incertaine mais à l’usage non moins répandu.
Notre société hyperconnectée a aussi ses peurs nouvelles. Ainsi, l' »Autophobie » témoigne de la crainte de se retrouver seul. La nature, elle, impose ses réalités : Orage supercellulaire et Larmes de sirène, nom poétique donné à ce qui l’est beaucoup moins, les billes de microplastiques qui polluent les océans. À noter aussi, la présence de PMR (Personnes à Mobilité Réduite), cécifoot (football pour déficients visuels), Pastille Crit’Air (écologie oblige), ou encore glamping (glamour + camping, pour les amateurs de confort au grand air).
Côté personnalités, Christine Angot, Sorj Chalandon, Léon Marchand, Gabriel Zucman et Cédric Klapisch entrent dans la danse.
La parité ? Toujours timide. Dans le dossier de presse, on a compté : seulement 14 femmes sur les 40 personnalités mentionnées comme rejoignant la sélection 2026…