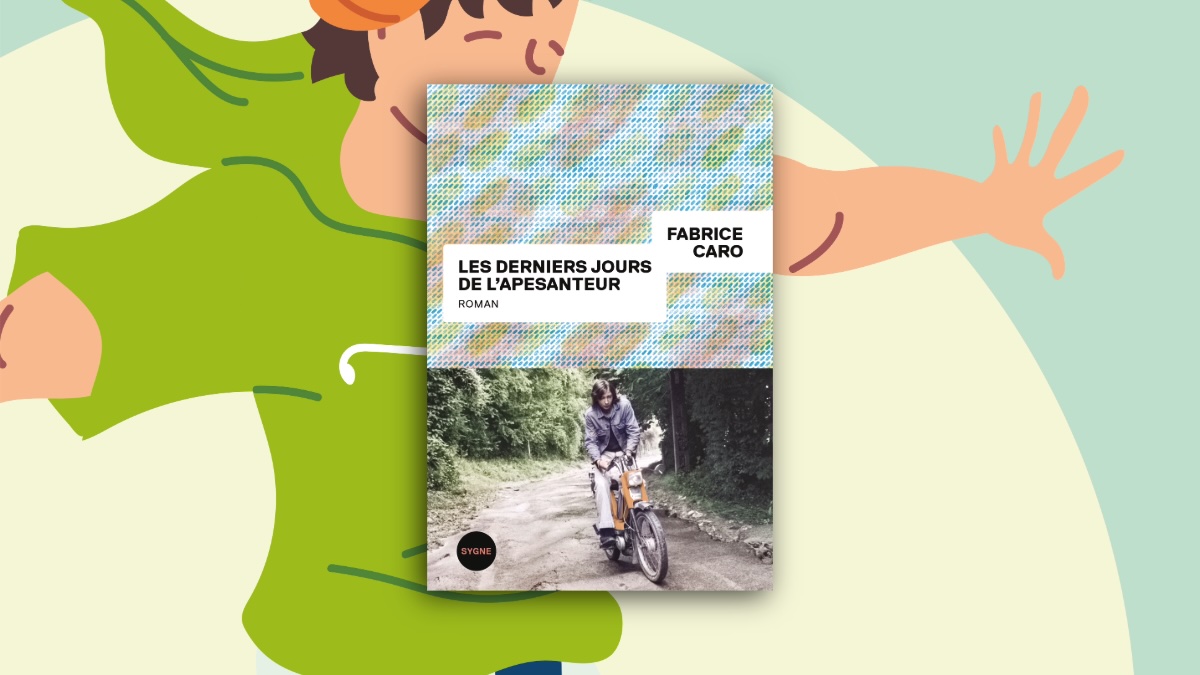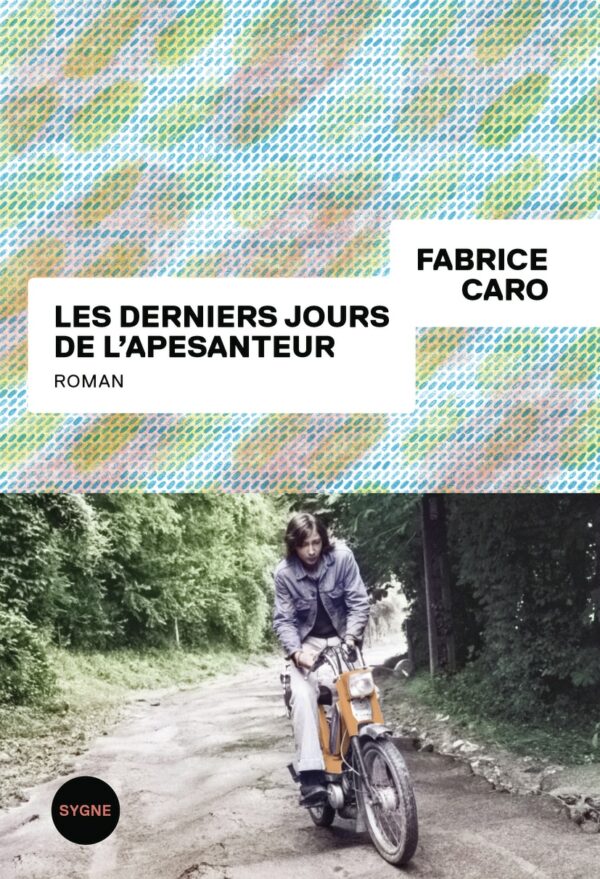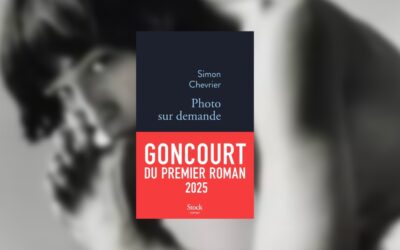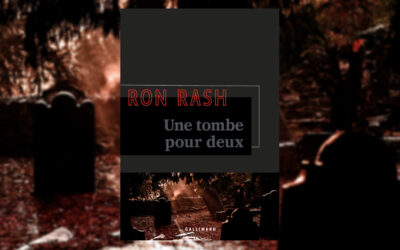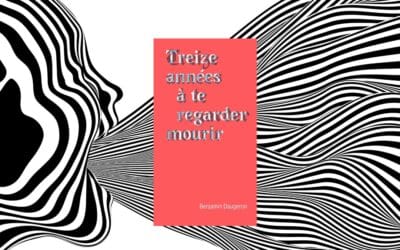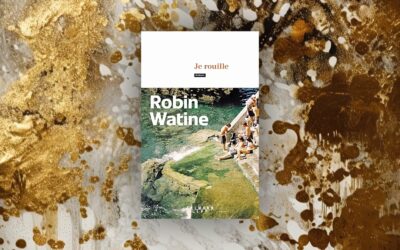Terminale années 80 : fin d’un cycle, fin d’un monde
Nous sommes à la fin des années 80, dans un lycée anonyme, avec ses bancs fétiches, ses récrés interminables, ses 4L bringuebalantes et Supertramp en fond sonore. Daniel, le narrateur, se remet difficilement de sa rupture avec Cathy Mourier : « Depuis Cathy Mourier, mon cœur était un champ de ruines. »
Avec lui, ses deux potes, Marc et Justin. Trois ados un peu paumés, bravaches et infantiles, qui passent leurs récrés à monter en mayonnaise chaque micro-drama. Car dans ce microcosme adolescent, tout prend des proportions démesurées : la confiscation d’un dessin du point G par une prof d’histoire provoque une panique générale, un appel téléphonique devient une épreuve existentielle (« c’est pour toi, c’est une fille », et le mot fille pesait des tonnes »), et rater une soirée équivaut à une petite mort.
Fabcaro déploie ici, sans aucun temps mort, son sens du comique de situation et des mots bien sentis. Il décrit « la meilleure période de notre vie en même temps que la pire », avec une tendresse infinie pour losers magnifiques, champions de l’à-peu-près, qui s’inventent des exploits : « C’était fou cette migration massive de Suédoises libidineuses qui, tous les étés, débarquaient massivement dans les campings de province pour dépuceler les lycéens. »
L’apesanteur et la chute
Tout en nostalgie, Les derniers jours de l’apesanteur radiographie une terminale où l’insouciance vacille : l’ombre de la loi Devaquet, la chute du mur de Berlin, les oncles qui meurent – « Premier magnétoscope, premier décodeur Canal+, premier micro-ordinateur, premier mort de la fratrie : mon oncle, Jean-Louis avait toujours un temps d’avance sur tout le monde ». Daniel, contraint de renoncer à une boum pour cause d’enterrement familial, enchaîne les fiascos. Il donne pour cinquante francs de l’heure des cours de maths à une élève dont le niveau décline mystérieusement, sous l’œil d’une mère résolument entreprenante, prête à lui enfouir la tête dans son décolleté à la moindre occasion.
Et quand l’ordinaire ne suffit pas, on invente : la disparition de Félicien Lubac, théâtralisée comme une affaire d’État : « Nous nous apprêtions à tenter de résoudre une affaire de la plus haute importance, alors que nous n’étions même pas capables de résoudre les plus insignifiantes de nos propres vies, enregistrer la bonne cassette, peindre correctement une porte de chambre, dessiner des vagins sans se faire prendre. ».
Avec Fabcaro, l’absurde côtoie sans cesse la mélancolie. « Mec, dans cent ans, on est morts », répète Justin pour justifier tous les écarts, les plus brillants comme les plus ineptes. Derrière la drôlerie, la gravité : « Un jour, on se retournerait et on comprendrait qu’on avait sacrifié les plus belles années de nos vies… et on réaliserait que les journées qu’on avait économisées étaient désormais totalement dévaluées. »
Enfin, arrivent les résultats du bac. Les voilà bientôt catapultés dans la vie d’adulte. « L’enceinte du lycée ressemblait à la cour d’un asile psychiatrique. Derrière ce portail, c’est la fin d’un cycle, de nos années lycée, de notre adolescence, des années 80. Nous venions de vivre le dernier jour de la pesanteur. »
On aimerait se retrouver, le temps d’une journée, aux côtés de Daniel, Marc et Justin. S’asseoir à nouveau sur ces chaises peu confortables, rire de tout et de rien, et sentir, encore une fois, l’étrange vertige des derniers jours de l’apesanteur. C’est jouissif, truculent, et ça fait un bien fou.