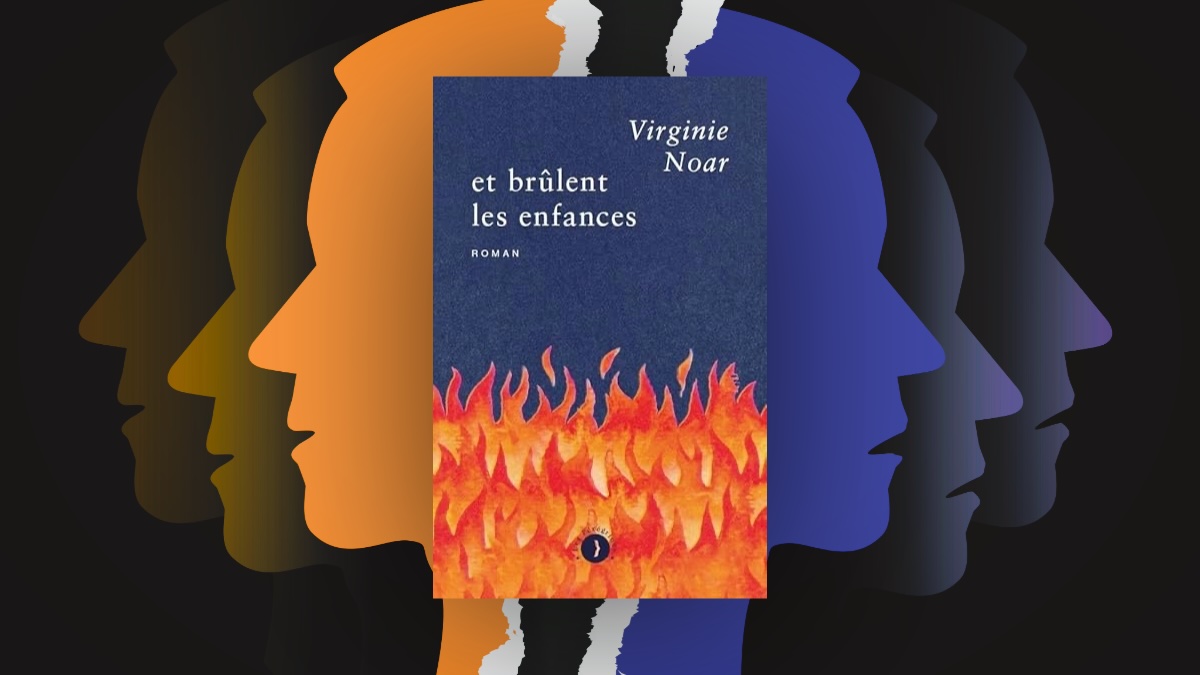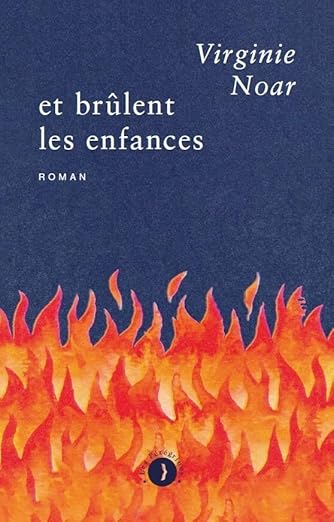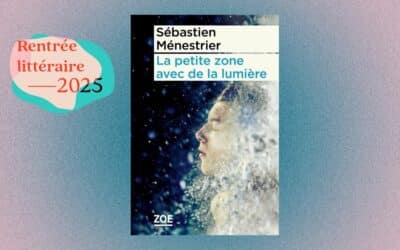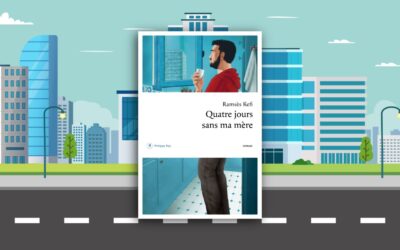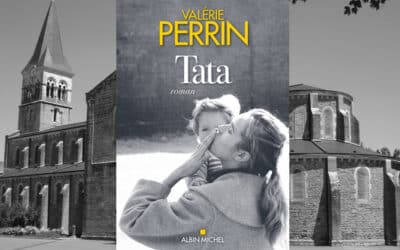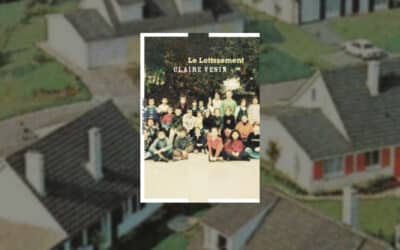Le théâtre du chaos
Le décor est planté : une chambre exiguë dans un appartement modeste, cube parmi les cubes d’un immeuble sans âme. Alice, enfant mutique, contemple comme une relique une carte postale de la tour Eiffel aux bords cornés. Dans un coin, son petit frère « aux rêves variables » est rejoint dans son lit par Annick, la mère. Elle fuit la chambre conjugale, là où se tient désormais reclus celui qui terrorise leurs existences.
Pourtant, Adama fut d’abord un soleil, une joie de vivre dans leurs existences atones. Les enfants l’ont accueilli avec l’espoir de ceux qui manquent cruellement d’une figure parentale. Mais brusquement, la nuit. Revenu d’un séjour au pays, Adama est méconnaissable : violence soudaine, indifférence radicale. Quel drame s’est joué lors de ce voyage ? Son mutisme contraint Alice à fantasmer « les images du corps noir dans les mers, du corps noir fuyant la flicaille, de la peur qui tabasse le plexus et de la justice qui tabasse les fautifs ». Pour les enfants qui adoraient ce nouveau beau-père, la tragédie est totale.
Annick, mère de plus en plus cabossée, oscille entre un amour immense pour sa progéniture et un autre, infernal, « pour un homme qui démolit ». Elle s’épuise à maintenir les faux-semblants, ne parvient « à rien d’autre qu’à s’affairer fébrilement autour de besognes chronophages, épluchage de prospectus, tri du courrier, tâches administratives », comme si la somme de petits riens pouvait colmater les fissures. Alice, déjà très investie auprès de ses frères, devient mère de substitution : elle materne, console, bouche les carences, porte la fratrie à bout de bras.
Dans cette vie d’adulte avant l’heure, Alice s’agrippe à un unique fil de lumière : « l’espoir de Marie », cette petite sœur tant désirée. Mais lorsqu’elle naît enfin, ce n’est pas le salut attendu mais un pas de plus vers le désastre. « Quand Marie est née, c’était déjà la pagaille. Enfin il y avait surtout le silence et la poussière d’après les guerres et les effondrements, à ceci près que l’effondrement se faisait ici en arrière-plan du visible, s’échafaudait sans bruit. »
Marie, l’espérance fragile, devient l’illustration la plus cruelle : même l’amour ne suffit pas à conjurer l’effondrement. Baptiste, enfant torturé, s’égare « dans les limbes de son invariable douleur » et Sami, une fois adulte, disparaît en coupant les ponts.
Car les traumatismes, eux, ne s’arrêtent pas à l’enfance : ils colonisent les vies futures. « Quelques années plus tard, alors que nous serions déjà affairés à une autre vie, moi toujours prompte aux contradictions, amours impossibles et névroses lancinantes, sourdes violences et colères indomptables. »
Sous le vernis ordinaire, le trauma s’est logé là, sous la peau : « méduses souterraines et aphones », angoisses reportées, névroses compulsives. C’est ce qui fabrique l’adulte, cette intranquillité sourde, ces vies fissurées qui semblent banales mais restent marquées au fer.
« Et nous pensons ici à ces enfants qui lorgnent la liberté… si ces enfants font des sottises, ils ont derrière eux quelqu’un pour les ramasser quand ils tombent. Tandis que d’autres n’ont personne ; s’ils tombent, ils doivent aller jusqu’en bas, et une fois là se ramasser tout seuls, s’ils ne sont pas cassés. »
La langue-rivière de Virginie Noar
C’est une langue de désespoir que celle de Virginie Noar, portée par une écriture rugueuse et viscérale. Une langue-rivière, qui coule sans digue et charrie tout sur son passage, sans silence ni haltes, jusqu’à devenir un flot, un ressac, une logorrhée assumée. Par moments, le texte s’enlise dans des répétitions et une épaisseur stylistique qui en alourdit l’élan. Mais n’est-ce pas la fonction d’une langue qui cherche à dire « ce qui a lieu dans la viande de nos corps quand on est à deux doigts de crever » ? Car quelle beauté que cette insistance à circonscrire l’indicible :
« comment
oui comment
comment dirons-nous les corps tombés au champ d’honneur,
comment dirons-nous sans silence,
comment, sans exciter les appétits monstres, dirons-nous la violence. »
Ou encore :
« Baptiste m’avait entraînée dans la chambre parentale et j’avais été engloutie à mon tour.
Et comment dire cela. Dire
l’engloutissement
le goût métallique qui ravit la langue
les sanglots du môme
l’obscurité monstre
le chuchotement d’Annick
les phalanges resserrés sur le cou blanc
la dévastation. »
Écrire pour ne pas sombrer
Enfance volée, amour dévastateur, trauma sans fin : le texte de Virginie Noar est une tentative inlassable de dire ce qui lacère, ce qui reste incrusté dans la mémoire corporelle. Tenir debout par l’écriture quand il n’y a plus que ça : « je me dis que la vie aura été cela exactement, une tentative inlassable de faire quelque chose de ces jours à vivre, et je me dis que quand il n’y a que l’écriture et l’espoir pour nous tenir debout, c’est que quelque part on est déjà un peu morte en dedans. »
Dans ce roman dense, Virginie Noar saisit ce que la violence et l’intranquillité font aux corps. Elle ne sacrifie pas la puissance de son style à l’académisme : elle assume une langue de désespoir, poétique, toujours au bord de l’opacité. Famille insuffisante mais aimante, enfance volée, effondrement inexorable : et brûlent les enfances est moins une histoire qu’une tentative — celle de dire l’indicible, et d’en faire littérature.