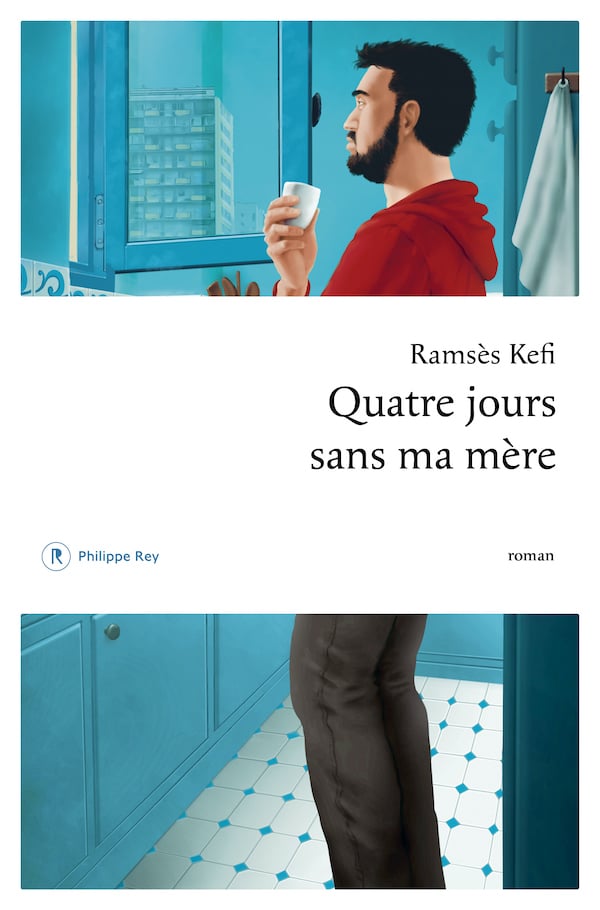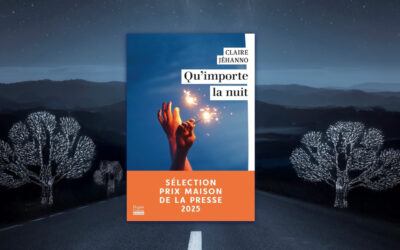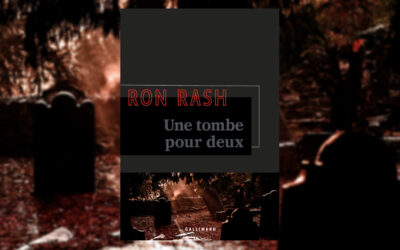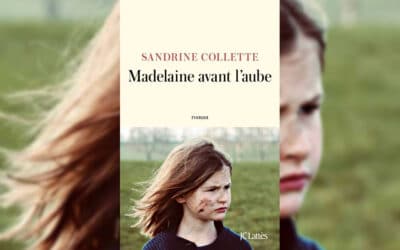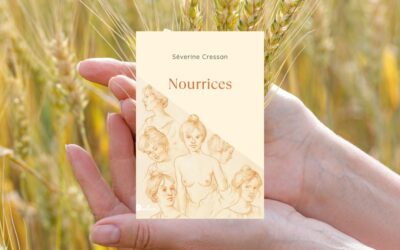Il fait nuit. Parmi la bande de galériens et de nostalgiques qui traîne sur le parking de la cité de la Caverne, personne ne s’attend à voir débarquer Hédi, le père de Salmane, venu chercher son fils en catastrophe.
Amani, mère dévouée et épouse effacée, s’est volatilisée. Sans explication, sans cris, sans effusion : un coup de fil lapidaire au mari, un mot laissé au fils. Comme si la vie de famille, pourtant faite d’habitudes indestructibles, pouvait se défaire sans préavis. « Avant de tailler sa route, Amani n’a rien changé à ses habitudes. C’est peut-être ça, le plus badant, partir en respectant la routine. Elle a cuisiné et étendu le linge. »
La Caverne, monde clos
Salmane, trente-six ans, végète dans sa cité, La Caverne, sept tours HLM décorées de graffitis pseudo-préhistoriques. Un coin de banlieue qui tient lieu de monde entier : on s’y enferme, on s’y surveille, on y bavarde. « Ici, une femme ne se barre pas en laissant un homme à la maison. Elle doit rester, quoi qu’il en coûte, quitte à se bousiller elle-même. »
Dans ce décor, Salmane « sédentaire radicalisé, soulevé d’un haut-le-cœur à la simple idée de prendre le large » mène la vie d’un adolescent attardé. Master d’histoire ancienne en poche, il travaille dans un fast-food et dort encore dans sa chambre d’enfant tapissée de Schtroumpfs. À La Caverne, s’accroche à ses potes d’enfance, des gars en fin de trentaine « qui se réveillent à l’envers (…) et se plaignent de tout par principe » – dont Archie, « qui ne veut plus entendre parler de la lumière du jour ».
Portraits en creux
Sa hiérarchie est immuable : Dieu au septième ciel et, au huitième, la réputation de sa famille.
La disparition soudaine de la mère agit comme un électrochoc. Le père pète les plombs, s’épuise à cacher l’absente face aux rumeurs qui vont bon train – à La Caverne, les murs ont des oreilles -, démonte les meubles et retire son alliance, comme si nier le vide pouvait suffire. Hédi s’épuise à démonter les meubles, à cacher l’absence sous un tournevis et à retirer son alliance, comme si nier le vide pouvait suffire. Pendant qu’Hédi s’escrime à faire disparaître toute trace de sa vie d’avant, Salmane, lui, cherche à comprendre, et « découvre comment l’inquiétude peut torturer un corps. » « J’ai déjà compati pour des copains de la Caverne ensevelis sous les emmerdes, mais je n’ai jamais porté de fardeau qui me donne envie de vomir mon cœur. »
Dans ce chaos, Amani apparaît plus que jamais. Figure absente, fantôme central. Héroïne silencieuse que l’on a négligée – jusqu’à oublier son anniversaire. On devine le burn-out d’une femme sacrifiée, usée par le je-m’en-foutisme des siens. Le roman, tout entier, est un portrait de femme alors même qu’elle n’est déjà plus là. Et si Amani était retournée en Tunisie, sur sa terre de naissance ? Pourtant Amani et Hédi ont toujours prétendu être orphelins…
Quatre jours pour grandir
C’est le portrait d’une famille minée par le silence, par le pourrissement lent du temps qui passe sans qu’on s’en aperçoive. Le départ d’Amani agit comme un révélateur : il met au jour des secrets d’exilés qui se prétendaient orphelins, des rancunes enfouies, des failles invisibles. Et il oblige Salmane à se confronter à sa culpabilité de fils trop absent, trop égoïste.
Quatre jours d’absence pendant lesquels Salmane mûrit en accéléré, quitte le confort engluant de l’adolescence pour devenir un homme. Quatre jours pour que les non-dits se fissurent, pour que les silences se brisent. Quatre jours que Ramsès Kéfi découpe avec brio en chapitres courts, nerveux, qui se lisent d’un souffle.
Douceur en creux
Malgré la douleur, le roman garde une tendresse omniprésente. Pour ce père ouvrier cabossé, pour ce fils maladroit, pour cette mère fantôme. Quatre jours sans ma mère n’est pas tant un roman de disparition qu’un roman de reconnaissance : reconnaître celle qu’on a trop longtemps tenue pour acquise, reconnaître que l’absence pèse plus fort que la présence muette. Un joli premier roman pour le journaliste Ramsès Kéfi.