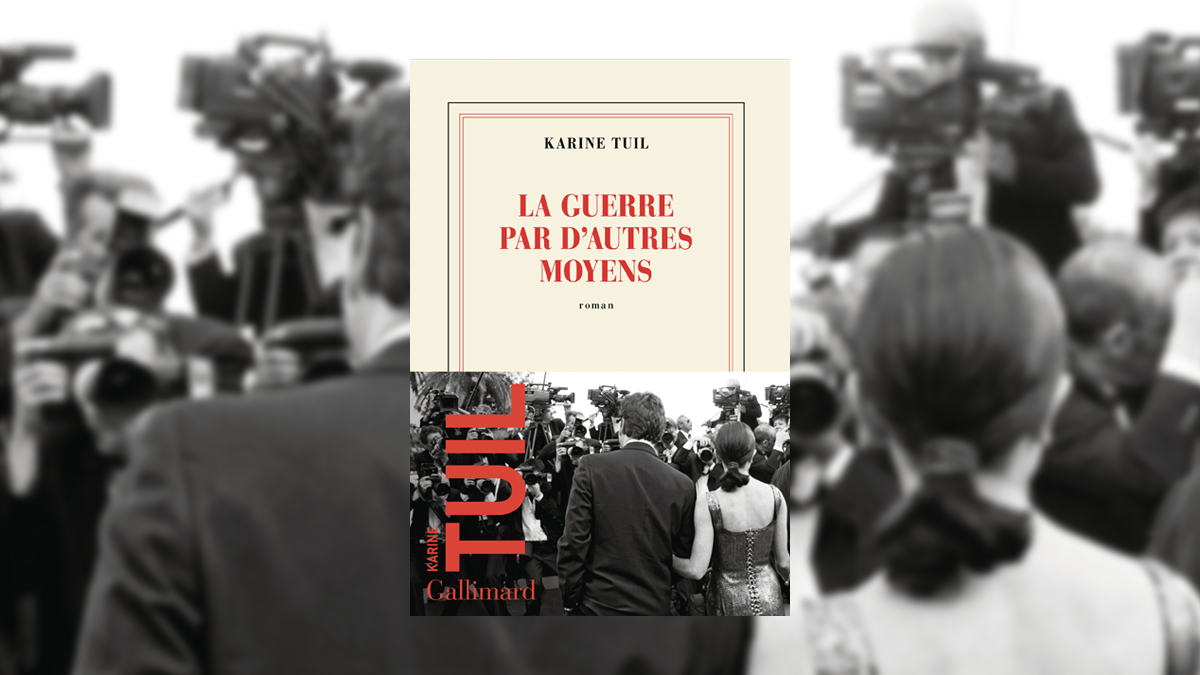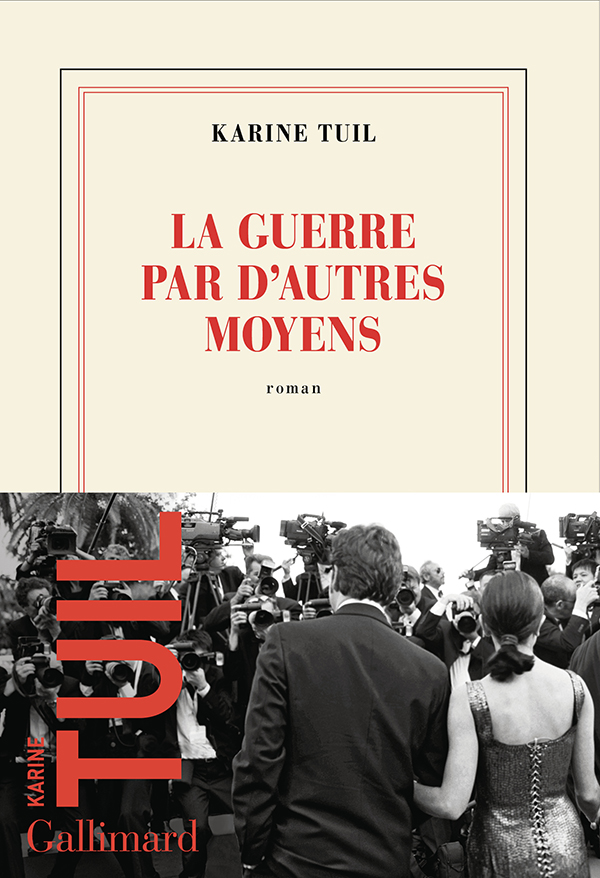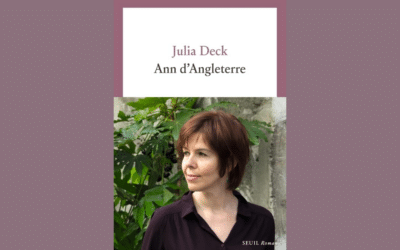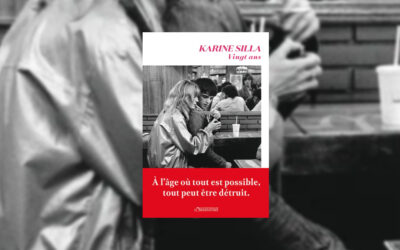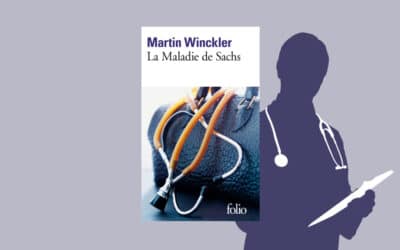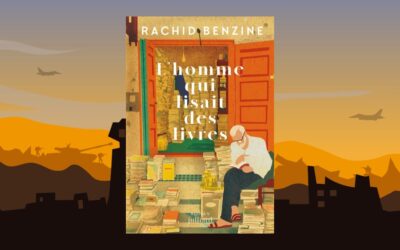La guerre par d’autres moyens, c’est d’abord une recette alléchante. Le lecteur vit dans la lecture et la typographie (choix intéressant, par ailleurs) la déchéance d’un ancien président, Dan Lehman, alcoolique de surcroît, mal remariée à une actrice obsédée par son image, qui couche avec un réalisateur en vue, archétype du prédateur metoo. L’intrigue foisonnante empêche de dire que l’on s’ennuie, mais la tambouille s’avère vite indigeste. Un trop-plein d’ingrédients : solitude du pouvoir, peur du temps qui passe, emprise, violences sexuelles, addictions, handicap, corruption, etc. qui brassent à l’envi les mots clés et les affres de l’époque actuelle. Un soap-opera servi par des dialogues stéréotypés et des rôles à la truelle : le vieux beau, la comédienne sur le retour, la femme bafouée quoique intègre, le réalisateur pervers narcissique, la jeune wokiste, l’enfant sourde… Tout ce petit monde, très auto-centré, essaie inutilement d’échapper au cataclysme de la vieillesse et de l’oubli. Les femmes, globalement soumises, trahies mais encore amoureuses, libres sur le papier mais pas vraiment, errent au gré du désir des hommes.
En somme ? Des relations amoureuses, affectives, sexuelles, dans tous leurs états, servies par des personnages qui jouent à l’amour et au pouvoir comme des Playmobils dans un château en plastique. Caricatural.
Intolérance, cruauté, cynisme. Karine Tuil, fine observatrice de ses contemporains et écrivaine à succès, nous a habitués à la comédie humaine sauce contemporaine. C’est le propos de Les Choses humaines et La Décision, qui sont de bons romans, malgré quelques platitudes de langages et assertions lourdes, que l’on retrouve aussi dans La guerre par d’autres moyens, comme « En politique, la seule chose qui tue, c’est le ridicule. » p. 194, mais qui passent quasi incognito tellement le reste est too much.
Mais là où le bat blesse véritablement, c’est dans la construction narrative. Les répétitions et les redites s’enchaînent et sautent aux yeux, créant l’impression désagréable de tenir entre les mains non pas un bouquin digne de figurer en librairie, mais des épreuves de texte. Un exemple parmi ceux relevés : p.94, est évoqué Paul, un personnage. « Lehman aimait sa compagnie, il était cruel et drôle, il racontait les dernières indiscrétions du monde politique, qui fait quoi, qui couche avec qui. ». On retrouve p.174 la même description à propos de Paul : « un électron libre qui savait distraire Lehman en racontant des ragots, en faisant des blagues ». Une fois, ça passe, plusieurs ?
Qui a édité Karine Tuil? C’est le grand Gallimard. Je sais comment fonctionne le milieu de l’édition, la compression des coups qui fait mal à certaines étapes de la chaîne du livre, notamment à la relecture, les Français qui lisent moins, la course à l’échalote du toujours produire plus pour se distinguer – 459 romans rien que pour la rentrée littéraire de septembre 2024, 9160 romans sur l’année 2023. Que la qualité se retrouve malmenée n’étonne guère. Gallimard, tout de même. Une machine de guerre, avec des moyens colossaux contrairement à de plus petits concurrents qui livrent, eux, une production exigeante. Gallimard, qui semble avoir préféré surfer sur la notoriété de son auteur et bâcler le boulot. À 22 € le bouquin, car oui je ne reçois pas tous les livres que je lis, ça fait mal. Effectivement, ça donne aussi une bonne raison de moins lire.
Ce qui m’amène au titre de cette chronique, Pourquoi (ne pas) chroniquer le dernier Karine Tuil, pourtant pas mal encensé par la presse ? Il y a dans la blogosphère littéraire une passionnée que j’aime beaucoup et qui revendique, à coups de roses et de couteaux, sa liberté d’encenser ou d’étriller ouvrages et auteurs. D’aucuns auront reconnu Littéraflure. Certain.e.s d’entre nous, dotés d’une belle notoriété, peuvent être faiseurs de roi. Mon passage à Libération, où l’on chronique, par principe, que ce que l’on a aimé, en procédant par degrés d’intensité, m’a interrogée sur nos pratiques. Certes, Citazine est loin d’être Libé, mais si l’important, c’est qu’on en parle, en bien ou en mal, ici j’aurais opté pour le silence.