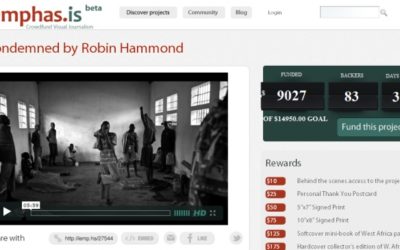Si l’émergence des réseaux sociaux et des nouveaux outils de communication avait déjà eu son importance dans le relais de l’information autour d’événements aussi majeurs que les attentats du 11 septembre 2001 à New York ou l’attentat de Londres en 2005, accélérant la propagation de l’information, il apparaît au regard des soulèvements arabes et berbères qu’Internet et les nouveaux médias ont désormais un autre rôle. Contre-pouvoir balbutiant il y a encore quelques années comme lors des législatives de 2005 en Egypte ou de la "Révolution verte" iranienne de l’été 2009, ce support a encore pris une dimension supérieure, endossant tout simplement le rôle de moteur. Une apparition très utile mais aussi déstabilisante pour des médias traditionnels qui ne manquent pas de s’interroger et semblent assez divisés. Quel a été l’impact des nouveaux médias et des réseaux sociaux sur la mobilisation des jeunesses tunisienne et égyptienne ? Internet n’est-il pas autant un outil de surveillance que de liberté ? Les réseaux sociaux sont-ils l’incarnation d’un contrepouvoir qui avait disparu ? Le web est-il devenu un nouvel espace politique ? Toutes ces questions étaient au cœur de la 18e édition du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, organisée du 3 au 9 octobre. Un événement de plus en plus suivi, par le métier et le public, et qui sacrait pour la première fois le webjournalisme.
« Au pays des hiéroglyphes, c’est l’@ qui a fait chuter Moubarak », affirme Claude Guibal, correspondante au Caire pour Radio France et Libération, auteur de L’Egypte de Tahrir. « On ne peut pas nier l’impact d’Internet et des réseaux sociaux. Moubarak et Ben Ali ont coupé Internet, qu’ils ne pouvaient maîtriser, pas les médias traditionnels qui étaient aux ordres. »
Grand reporter au Figaro, Delphine Minoui cite l’exemple de Khaled Saïd, jeune étudiant battu à mort par la police à la sortie d’un cyber café d’Alexandrie, le 6 juin 2010. En pleine rue, sous le regard de tous. A 28 ans, il avait diffusé sur Internet une vidéo montrant deux policiers se partageant de la drogue après un coup de filet. Les parents ne récupèrent que la photo de son visage prise à la morgue. Une atrocité qui se retournera contre le pouvoir en place. Wael Gonhim, représentant de Google au Moyen-Orient, crée alors une page Facebook, intitulée « Nous sommes tous des Khaled Saïd ». Le jeune homme devient une icône du web et son visage tuméfié le profil des usagers de Facebook. Le réseau social voit fleurir des groupes portant son nom, dont l’un d’eux comptabilise près de 500 000 membres (10 % des utilisateurs de Facebook en Egypte).
Des ordinateurs donnés par Ben Ali… ont permis de le chasser du pouvoir
Sur le site de micro-blogging Twitter, les internautes utilisent le hashtag "#khaledsaïd", au même titre que "#egypt" pour évoquer la révolte en cours. Le ralliement s’opère et la manifestation du 25 janvier lui est dédiée. Ce mardi historique, les manifestants égyptiens ne sont pas quelques centaines comme attendues ou espérées, mais dix mille. Le jeudi 27, Hosni Moubarak décide de couper l’accès à Internet. Grave erreur. La population s’organise. Le collectif d’internautes Anonymous, qui sévit sur le net contre tous actes liberticides, fournit aux Egyptiens des numéros de modem pour obtenir du réseau. Et ceux qui n’ont plus accès au net sortent dans la rue. La boîte de Pandore est ouverte. La contestation s’intensifie. En moins de trois semaines, le dictateur est renversé.
Quelques jours auparavant, le même scénario a eu raison du régime du président tunisien Ben Ali en mois d’un mois. Là aussi, Internet et ses possibilités ont agi comme un venin. « L’ironie dans l’histoire, c’est que c’est Ben Ali qui nous a donné des ordinateurs à des prix défiant toute concurrence, plusieurs années auparavant. Des ordinateurs verrouillés que nous avons réussi à débrider et dont nous nous sommes servis pour le chasser », relève Sofiane Belhaj, blogueur belgo-tunisien influent (170 000 connexions), décisif lorsqu’il a traduit et mis sur Facebook des câbles de Wikileaks révélant l’opinion des dirigeants étrangers sur Ben Ali. « La manifestation du 14 janvier à Tunis est un événement Facebook. Elle a donné lieu à des scènes merveilleuses. Des Tunisiens s’étaient postés sur les toits des immeubles. Grâce à Twitter, ils ont réussi à orienter les manifestants, leur permettant d’éviter les barrages de police. On a vu des policiers jeter leur casque par terre, de rage. »
Dans des pays où la population est très jeune (60 % ont moins de 30 ans), de plus en plus éduquée et équipée (5 millions d’utilisateurs de Facebook en Egypte en 2010 ; 75 millions de cartes SIM chez les 80 millions d’Egyptiens), les mouvements s’embrasent comme des feux de paille. Durant la semaine précédant la chute d’Hosni Moubarak, le nombre de tweets concernant les changements en Egypte est passé de 2 300 à 230 000 par jour à travers le monde. Les vidéos contenant des protestations ou des commentaires politiques se sont propagées massivement : 5,5 millions de visionnages pour les vingt-trois vidéos les plus regardées. Surtout, les discussions sur des blogs ou sur Twitter présageaient des retournements dans l’opinion publique. 100 000 personnes descendaient dans la rue en Tunisie pour protester contre l’ancien régime le jour où le mot "révolution" arrivait en tête des recherches sur les blogs du pays.
« L’affaire de cette fausse blogueuse gay de Damas a beaucoup marqué la profession »
« Facebook est une Agora moderne qui a permis aux Tunisiens de franchir la ligne rouge qu’ils s’étaient imposés eux-mêmes, d’abattre l’autocensure », continue Sofiane Belhaj pour qui le site internet Wikileaks a également joué un rôle. « Cela a contribué à la prise de conscience. Nous nous sommes rendus compte que les diplomates américains n’étaient pas tendres et qualifiaient le gouvernement de "sclérosé" et Zine el-Abidine Ben Ali, de "corrompu" et "kleptocrate". Nous, on sentait, on imaginait que le gouvernement était pourri de l’intérieur. Lorsqu’on a réalisé que l’étranger pensait la même chose, ça a été un déclic ».
Pour Delphine Minoui, Facebook peut même être comparé à un laboratoire d’expériences démocratiques. « En Syrie, les internautes votent pour élire le mot d’ordre de la manifestation hebdomadaire. On peut atteindre 300 000 votes. Il y a un indéniable effet boule de neige. »
Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans les pays où lnternet n’est pas très développé comme en Libye (5,5 % de la population connectés, sept fois moins qu’en Tunisie), les révoltes sont plus difficiles à faire aboutir.
Face à ce raz-de-marée, à côté de ces cyberdissidents, quelle place reste-t-il pour les médias traditionnels ? Selon Mohamed Krichen, présentateur vedette d’Al-Jazeera, chaîne elle aussi décisive lors du Printemps arabe, la complémentarité est évidente. « Nous n’avions pas de correspondant en Tunisie car nous y étions bannis, explique-t-il. Couvrir l’événement était donc impossible. Nous l’avons donc fait uniquement à travers Facebook, des photos prises à partir d’un téléphone portable, de vidéos postées sur le net, auxquelles nous avons donné de l’ampleur. C’était une expérience tout à fait nouvelle mais aussi un moyen risqué car la qualité n’est pas la même et la question de la déontologie est posée. Sur 200 films, nous avons diffusé un ou deux faux, il faut le reconnaître. On peut être piégé. On a essayé de nous induire en erreur pour nous discréditer ».
« L’affaire de cette blogueuse gay de Damas qui était en fait un Américain vivant en Ecosse, Tom MacMaster, et dont les écrits ont été relayés pendant deux mois dans le monde entier, a beaucoup marqué la profession », insiste Delphine Minoui. Ce canular aurait en effet pu avoir des effets pervers, en mettant en doute la vérité des expériences livrées par d’autres bloggeurs syriens. Alors qu’eux témoignent réellement au péril de leur vie.
« Nous continuons à avoir besoin des "cinq W" (what, why, when, where, who) pour accepter de diffuser un film », note Patrick Baz, de l’Agence France-Presse. « Et d’ailleurs, c’est assez drôle car aujourd’hui, les manifestants filment un endroit spécifique et portent un panneau avec l’heure et le lieu ». Pour Rémy Ourdan (Le Monde), enfin, « les outils évoluent mais les recettes restent les mêmes. Le fond d’une révolution reste le courage physique et la politique ». Reste que « si Al-Jazeera n’avait pas fait ce pari, nous aurions été écrasés en silence », affirme Sofiane Belhaj.
Si les révolutions ne se gagnent toujours pas virtuellement mais dans la rue, il est indéniable que le virtuel a joué un rôle essentiel dans ces mouvements de révolte. Des individus unis par leur volonté de changement se sont retrouvés, fédérés sur Internet pour ensuite descendre ensemble dans la rue. Le cyberpower est bien réel et désormais les gouvernements devront faire avec. Les médias traditionnels aussi.