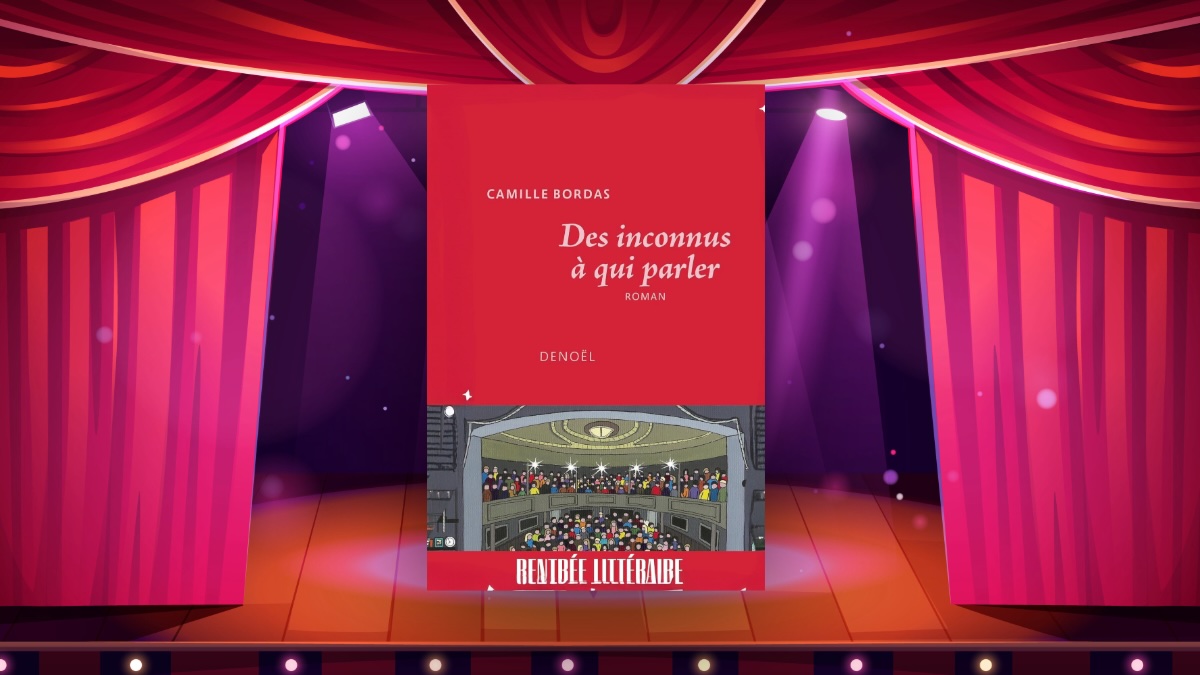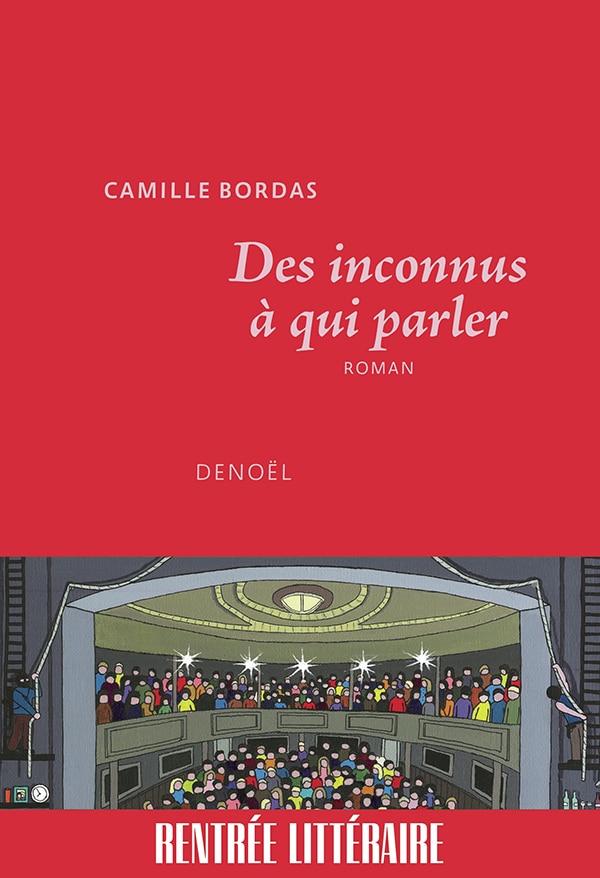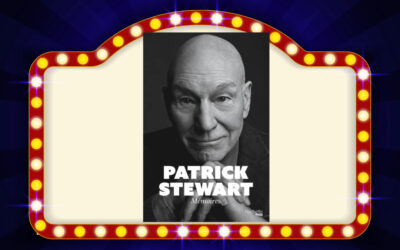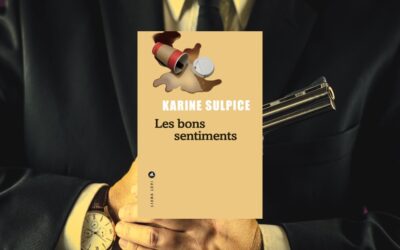Dans Des inconnus à qui parler, le nouveau Camille Bordas, on n’est pas à l’école du rire, mais au sein du master (fictif) de stand-up de Chicago, dont le premier semestre s’achève. Depuis quelques mois, Artie — trop beau pour être comique ? —, Olivia — quelque peu misanthrope —, Phil — le woke qui ne veut plus rire de tout —, et Jo — humour vache et répartie cinglante —, suivent les cours d’humoristes professionnels relativement célèbres, dont Dorothy et Ben Kruger.
Or, voilà qu’un nouveau professeur s’annonce pour le second semestre : Manny Reinhart, star accomplie du stand-up, attendu comme un messie malgré le scandale à la sauce #metoo qui lui colle aux basques. L’occasion de l’apparition inopinée de son fils, Auguste, étudiant en droit très – trop ? – sérieux dont la présence et les considérations feront vaciller la figure tutélaire. Le métier d’avocat était par ailleurs bien plus intéressant que celui d’écrivain (la carrière dont son père avait rêvé pour lui), parce qu’un avocat n’avait pas à placer l’histoire d’un client dans un continuum, de vérité de l’expérience humaine, (…) mais simplement à l’interpréter à l’aune de la loi, à en chercher les failles et à les combler pour gagner un procès, puis passer à autre chose.
Faire rire, mode d’emploi
L’enseignement du stand-up en milieu universitaire, en voilà un sacré paradoxe : tenter de rationaliser l’instinct, de théoriser la spontanéité — n’est-ce pas là mission impossible ? Camille Bordas s’empare de ce cadre quasi absurde pour interroger le rapport entre la vie et son expression comique, entre le vécu et sa mise en scène. Elle joue sur cette contradiction féconde : comment transmettre un art qui ne supporte ni les cadres ni les leçons ?
« La honte avait toujours été son moteur, c’était elle qui le poussait à écrire. Il avait toujours écrit dans l’espoir de faire oublier ses spectacles précédents, dont il finissait invariablement par avoir honte au bout de quelques semaines de tournée. La honte était au cœur de son processus créatif. »
Les étudiants du master apprennent à transformer honte et ratés en matière scénique. Faire rire devient une ascèse, un art du rebond, presque une discipline du désastre. Camille Bordas décrit avec un réalisme mordant le quotidien de ces apprentis humoristes : les ateliers où l’on dissèque les blagues ratées, les confessions forcées sur scène, les egos froissés par un silence de salle. Car faire rire est le Saint Graal — et son pendant, l’atonie d’un public muet, la crainte ultime, la crucifixion.
Mais comment mettre en scène sa propre existence, faire de ses pensées les plus intimes une matière comique sans se trahir ? Comment tourner en dérision les petites manies de son entourage sans les blesser ? Si on ne peut rire de tout, quels sont les red flags à ne pas franchir ?
Faire rire est un exercice à haut risque, où la lucidité côtoie l’épuisement. Il y a du Houellebecq dans les personnages de Dorothy et Ben Kruger, humoristes au mitan de leur vie, corps professoral fatigué, désabusé, qui observent le monde avec l’acerbe impression qu’il n’a plus rien à leur revendre. Sous l’humour, la fatigue d’exister. Oui, le rire a bien quelque chose de grave.
Le comique du désarroi
Roman choral où chacun a longuement la parole, Des inconnus à qui parler met en scène des personnages qui se débattent avec leurs certitudes et leurs fragilités, oscillant sans cesse entre le désir d’être aimés et la peur du ridicule. « Un artiste était tout le contraire de ça, un artiste ne connaissait pas sa place : le gros du travail consistait en un ping-pong effréné entre mégalomanie et haine de soi. ».
« Elle s’était dit que Sword répondrait peut-être à son texto pendant qu’elle écrivait sa note sur les jumeaux, car c’était aussi à cela que ça servait, prendre des notes, à tuer le temps en attendant que quelque chose se produise dans la vie. Après quoi la vie réelle redevenait rapidement un sujet sur lequel prendre des notes, ainsi de suite, jusqu’à ce que mort s’ensuive. »
Comme chez Houellebecq, la lucidité frôle la désespérance, mais l’ironie devient ici un rempart contre les désastres ordinaires, ces moments où la conscience du monde devient trop grande pour être supportée autrement que par le rire. Il y a aussi, chez Camille Bordas, du John Irving, dans la tendresse pour les êtres décentrés, dans la manière de dire l’absurde et le fatalisme du quotidien sans cesser de croire à la possibilité du rire. Elle croque des personnages un peu paumés, mais profondément humains, sacrément lucides sur la comédie du monde.
Le roman, traversé de micro-scènes d’observation sociale, devient aussi une radiographie du malaise contemporain : la compétition, la peur du faux pas, la culpabilité morale, la solitude connectée. Sous le vernis du rire, une question émerge : que reste-t-il à sauver quand tout est devenu matière à performance ?
Écrire et vivre la vie
« L’idée que tout dans sa vie pouvait devenir matière à sketch ou à spectacle l’apaisait autant qu’elle l’exaspérait. Elle ne savait jamais vraiment si elle vivait quelque chose ou si elle était déjà en train de l’écrire. »
Comment ne pas s’empêcher de vivre, en pensant sans cesse à ce que l’on pourrait écrire sur ce que l’on vit ? Rêveurs, désenchantés, lucides, nos humoristes sont-ils de ceux qui ne font que regarder vivre les autres ? Camille Bordas observe avec une précision d’entomologiste la mécanique du rire comme celle d’une survie émotionnelle. Le stand-up devient la métaphore d’un monde saturé d’opinions, où chacun cherche désespérément à exister à travers la parole, quitte à s’y dissoudre.
C’est là qu’intervient Ben Kruger, humoriste vieillissant, qui s’échappe de quelques heures pour rendre visite à son père en Ehpad. Au lieu d’une réconciliation émouvante, il se retrouve — presque malgré lui — à apprendre le tir au fond du parc de l’établissement avec deux pensionnaires un peu allumés du casque. Kruger, qui croyait avoir perdu le sens du comique, expérimente de nouveau la drôlerie brute de l’existence. Camille Bordas semble rappeler à ses personnages — et à nous, lecteurs — qu’à force de tout calculer, de tout rationaliser, on finit par oublier la force tellurique du simple ordinaire. Le comique naît de la friction avec le réel, du hasard, du tremblement. Certes, il a besoin d’être pensé, mais surtout d’être vécu.
« Il était rare que des mots spécifiques apparaissent dans son esprit avant qu’elle ne les prononce, ou ne les écrive (…) c’était peut-être pour cela qu’elle écrivait, au fond. Pour savoir ce qu’elle pensait. » Est-ce donc cela, être humoriste ? Écrire – ou parler – pour comprendre ce qu’on ressent, et rire pour survivre à ce qu’on ne comprend pas.
Roman d’une lucidité tendre, Des inconnus à qui parler interroge ce que le rire parvient à sauver du désastre.
Camille Bordas, française installée depuis quinze ans aux États-Unis, se traduit elle-même — et c’est sans doute dans cette double langue que se forge son ton si singulier désabusé, ironique, compatissant.
Une lecture exigeante, mais jubilatoire, qui rappelle qu’entre honte et drôlerie, nous partageons tous la même scène.